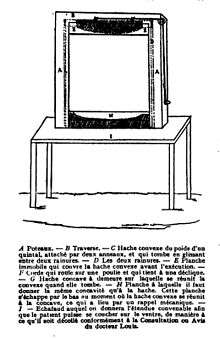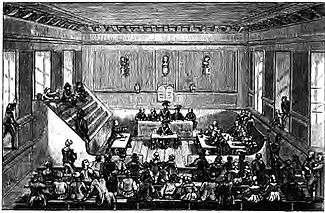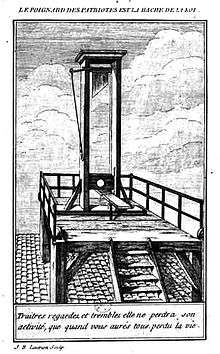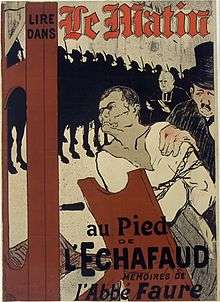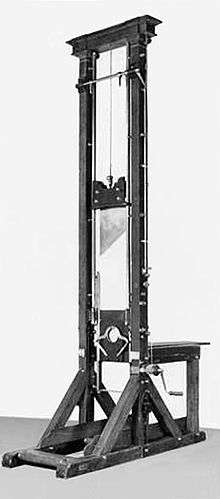La guillotine typique : les deux montants verticaux, reliés par une traverse, comportent une rainure dans laquelle coulisse le couperet maintenu en haut par une corde.
Guillotine, modèle Berger 1872, construite vers 1890. L’homme à la droite en est le propriétaire, Fernand Meyssonnier, qui fut premier aide de l'exécuteur à l'époque de l’Algérie française.
La guillotine est une machine de conception française, inspirée d’anciens modèles de machines à décollation, et qui fut utilisée en France pour l’application officielle de la peine de mort par décapitation, puis dans certains cantons de Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne. En France, une guillotine fonctionna à la prison des Baumettes pour la dernière fois en septembre 1977, et fut remisée définitivement, après l’abolition de la peine de mort en 1981, à la prison de Fresnes.
Selon les experts médicaux, la section de la moelle épinière entraîne une perte de connaissance instantanée (exactement comme pour une pendaison dite long-drop).
La guillotine en délibération
Un prélude à la simplification de la peine de peine de mort
Le 24 août 1780, Louis XVI, conseillé par Pierre Lenoir, alors lieutenant-général de police, avait le premier supprimé la question préparatoire qui devait suppléer à l’insuffisance de preuves et qui, au cours même de l’instruction, ne considérait jamais l’accusé comme un possible innocent. Cette procédure était renforcée par la sellette qui mettait encore le prévenu en tenue et position humiliantes, et en faisait ainsi un coupable désigné dont il ne restait plus qu’à forcer l’aveu. Le roi s’inspirait, mais en plus timide, de la réformation du code pénal du grand-duc de Toscane Léopold Ier, son beau-frère.
« Tout reposait alors sur deux principes, la vengeance publique et la terreur, partout la tendance à établir l’analogie matérielle entre le délit et la peine, à proportionner l’une à l’autre d’une manière rigoureuse et mathématique, au moyen d’une échelle de tortures savamment graduée ».
Le 1 mai 1788, une déclaration du roi s’attaqua cette fois à la question préalable, qui avait pour but d’obtenir par une dernière torture la dénonciation des complices. Les termes mêmes employés par le roi font état de ses précautions vis-à-vis d’une magistrature française ancrée sur des procédures séculaires à partir desquelles elle tirait la plupart de ses capacités. Mais le roi n’eut pas le temps d’y donner suite et c’est l’Assemblée constituante qui allait plus tard entériner cette intention par la loi du 8 octobre 1789.
La croisade philanthropique d’un franc-maçon

CIVI OPTIMO : À un illustre citoyen. Une devise tirée d’Horace : « Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in hoc sum » : Mes soins et mes interrogations sont à la recherche de la vérité et de l’harmonie, et je n’ai pas d’autre but.
Joseph Ignace Guillotin, député constitutionnel, n’était pas un parfait inconnu et s’était auparavant fait connaître à ses collègues politiques par ses initiatives inspirées en d’autres domaines, particulièrement sa collaboration dans la Déclaration des Droits de l’Homme. Il avait aussi fait partie de la première commission nommée par le roi le 12 mars 1784 afin qu’elle examine le mesmérisme et en donne ses conclusions.
On ignore comment Guillotin s’était convaincu de l’idée de la décapitation et s’il avait à cette époque une conception précise du fameux « mécanisme ». Sans doute, était-il déjà entré en relation avec son confrère Antoine Louis, ancien chirurgien militaire. Peut-être aussi en a-t-il conféré avec Sanson, ou ses frères de la loge « La Candeur » (la loge de La Fayette et de Laclos), ou bien au Club de 1789, où se côtoyaient plus de quatre cents membres dont Rabaud-Saint-Étienne, Chénier, Brissot, Bailly, Lavoisier et Custine, qui, tous, un jour prochain, iront « demander l’heure à la fenêtre nationale ».
Les premières déclarations du député
Le 10 octobre 1789, Guillotin lit un discours préliminaire devant l’Assemblée nationale. Les idées égalitaires qui y sont développées séduisent l’Assemblée. Selon Louis Du Bois, aucune copie de cette intervention n’a été enregistrée. Le Moniteur du lendemain rapporte simplement que Guillotin s’est appuyé sur le principe que la loi doit être égale pour tous, aussi bien quand elle punit que lorsqu’elle protège. On peut facilement deviner les divers points qui ont alors été évoqués. Le docteur fut fréquemment applaudi et certains députés voulurent délibérer tout de suite. Mais comme une séance spéciale sur le Code criminel était prévue, la question fut ajournée.
La petite phrase du médecin
« "Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point." ».
Cette phrase prononcée au cours de son allocution, paraît-il en réponse à l’objection d’un député, est la plus fréquemment attestée par les contemporains ; mieux que l’expression « un souffle frais sur la nuque », qui est parfois reprise dans des ouvrages récents sans précision de la source. Fleischmann mentionne également cette dernière expression, mais, ne prêtant qu’aux riches, l’attribue directement au « caustique docteur Louis ».
La formule « en un clin d’œil » du naïf Guillotin, eut un succès inattendu puisque les chroniques du temps s’accordent à dire qu’elle fit s’esclaffer toute l’Assemblée. Fleischmann fait remarquer que l’expression est commune aux deux médecins. Elle avait été, en effet, employée par Louis pour conclure ses instructions de fabrication adressée au sieur Guidon, et a donc l’avantage d’avoir été écrite de sa main. On en est réduit à supposer que l’un d’eux l’avait prononcée le premier et que l’autre l’avait répétée. Encore une fois, le même auteur n’hésite pas à la mettre au compte du pince-sans-rire docteur Louis, en raison de l’humeur du personnage qui avait terminé ses instructions : « S’il y avait quelques erreurs dans ces détails, elles seraient faciles à vérifier par le constructeur le moins intelligent » ; et qui avait placardé sur la porte de son cabinet : « Ceux qui viennent chez moi me font honneur, ceux qui n’y viennent pas me font plaisir ».
En outre, l’expression « avec ma machine » allait avoir un retentissement que Guillotin n’aurait jamais soupçonné car il pensait certainement exprimer sa prédilection pour un type d’instrument automatisé, semblable à ce qui existait dans d’autres pays. Cette machine nimbée de mystère pour ses collègues, encore anonyme et qui venait d’éveiller la curiosité, devint tout à coup « la machine à Guillotin ». Pis, le journal polémiste royaliste, Les Actes des Apôtres, se gaussa comme il se doit de cette nouvelle lubie de révolutionnaires, d’autant plus qu’il gardait un ressentiment à l’encontre de l’homme politique et de son action en faveur du tiers état avec sa « Pétition des six corps ». On fit une chanson – mais il y en eut d’autres moins convenables - qui contribua, et non parmi les moindres, à attacher à cette machine le nom de Guillotin pour la postérité. Le nom de guillotine s’imposa donc rapidement et écarta la « louisette » (ou « louison ») forgée à partir du nom de son concepteur mais restée dans un cercle restreint. Les publicistes avaient même songé à l’appeler « mirabelle » tant l’ex-comte de Mirabeau donnait des coups de boutoir à la monarchie.
La chanson, sur l’air du menuet d’Exaudet, avait pour titre : « Sur l’inimitable machine du médecin Guillotin propre à couper les têtes et dite de son nom Guillotine » . Dont voici le dernier couplet :
-
Le romain
-
Guillotin
-
Qui s’apprête,
-
Consulte gens de métier
-
Barnave et Chapelier,
-
Même le Coupe-tête [Jourdan dit « Coupe-tête »]
-
Et sa main
-
Fait soudain
-
La machine,
-
Qui simplement nous tuera
-
Et que l’on nommera
-
Guillotine.
La motion du 1 décembre 1789
Guillotin reprend ses réflexions sur le code pénal. Ses propositions, défendues par l’abbé Pépin, sont cette fois versées au Journal des Débats et des Décrets :
-
1- Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l’état [la condition sociale] du coupable.
-
2- Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable ; le coupable sera décapité ; il le sera par l’effet d’un simple mécanisme.
-
3- Le crime étant personnel, le supplice quelconque d’un coupable n’imprimera aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent [la parentèle] ne sera nullement taché, et tous continueront d’être également admissibles à toutes sortes de professions, d’emplois et de dignités.
-
4- Nul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice quelconque d’un de ses parents. Celui qui osera le faire sera publiquement réprimandé par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du délinquant. De plus, elle sera et demeurera affichée au pilori pendant trois mois.
-
5- La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas.
-
6- Le cadavre d’un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.
Le duc de Liancourt avait désiré, de son côté, hâter la décision car de nombreux condamnés attendaient leur sort et risquaient de voir s’abattre encore sur eux l’ancienne barbarie. L'Assemblée approuve les propositions de Guillotin mais, faute de temps, reporte les délibérations. Seul, le premier article est provisoirement adopté. Mais l’idée était lancée et le docteur avait fait admettre comme légitimes, par la majorité des représentants, des principes humanitaires et égalitaires.
Vers le vote final
Les délibérations sur la justice pénale se feront en plusieurs étapes au cours de décembre. Le 20 janvier 1790, Guillotin réexpose les divers points concernant son projet sur l’exécution capitale. Quatre des précédents articles sont acceptés (les 1,3, 5 et 6) et seront présentés, le lendemain, à la signature du roi ; les deux autres sont ajournés. Est désormais protégée la parentèle qui subissait depuis toujours les conséquences des méfaits d’un de ses membres. Les historiens du temps n’ont pas failli à remarquer que le 21, date de la sanction royale, sera le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, trois ans plus tard.
Le 3 juin 1791, après des délibérations en mai sur la torture, le député Le Peletier-Saint-Fargeau (il n’a plus sa particule) propose d’inscrire en article 3, titre 1, du code pénal, la définition suivante : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Le 25 septembre, puis le 6 octobre 1791, les législateurs adoptent et votent les articles 2 et 3 du code pénal qui s’énoncent ainsi :
-
2° La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.
-
3° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
-
4° Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu d’exécution revêtu d’une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire ; il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution.
La quasi tautologie, « la mort est la simple privation de la vie », souligne l’importance du mot « simple » car cette définition en finissait avec la torture. Montaigne l’avait déjà dénoncée : « Tout ce qui est au-delà de la mort simple, me semble pure cruauté ». Ces articles venaient d’arrêter toute mise à mort tant que la machine qui devait tuer rapidement avec un minimum de souffrance et d’intervention humaine, restait à construire. De plus, ces articles omettaient de désigner celui qui serait chargé de l’exécuter. Une lettre en date du 2 mars 1792 du commissaire Verrier à Roederer résume la situation : « […] J’augure par le silence que vous gardez que vous n’êtes pas décidé sur cet objet ; […] il est instant que le public ait un exemple sous les yeux ; les assassinats se multiplient, et les bons citoyens se plaignent et gémissent de l’inertie et de la négligence que l’on met à exécuter la loi. Je ne vous écris que d’après le vœu de mon tribunal ». Le choix de la décollation fera rugir le « zélé partisan des idées nouvelles », Raymond Verninac de Saint-Maur dans le journal « Le Modérateur », et qui la dénoncera comme « un supplice d’aristocrate et pas assez honteux ».
Un code qui fit date
Ces articles novateurs seront repris vingt ans plus tard lors de la promulgation du Code pénal en date du 12 février 1810, au chapitre premier des « Peines criminelles » :
-
12° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
-
13° Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation ; « il aura ensuite le poing droit coupé », et il sera immédiatement exécuté à mort.
-
14° Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil [dans la discrétion].
la mention entre guillemets du 13° sera abrogée par la loi du 28 avril 1832. Elle montre que l’abomination du parricide restait bien vivace, mais que, de toute évidence, cette résurgence d’un acte de cruauté entrait en contradiction avec un article fondamental de 1791. Cette loi du 28 avril 1832 introduit également la notion de circonstances atténuantes généralisées à l'ensemble des crimes, si bien qu'on passe de 100 condamnés à mort en moyenne avant 1832, à 50 en 1833, 5 en 1870.
Les ancêtres de la guillotine
Rien ne permet d’affirmer que le docteur Guillotin se soit donné explicitement comme l’inventeur de la guillotine. Mais il est certain qu’il en imposa le premier le principe en France où il était pratiquement ignoré. Tout au plus peut-on lui reprocher des expressions ambiguës qui, sorties de leur contexte, ont été mal interprétées ; et la machine lui fut attribuée malgré lui. Quelques ouvrages se sont empressés par la suite de rétablir la vérité, notamment la « Notice sur la guillotine » d’Adolphe Bloeme (1835).
Décapitation de saint Pancrace imaginée au début du XVI siècle
Martyre de saint Matthieu imaginé par Cranach
Manlius utilise une machine romaine pour décapiter son fils (gravure de Aldegraver)
Décollation en Irlande de Murdoch Ballagh
Exécution du duc de Montmorency à Toulouse en 1632
La Mannaia italienne
Gravure d'après Bonasone (1555)
Le chroniqueur Jean d’Authon décrivait déjà au début du XVI siècle une doloire ajustée dans un « gros bloc », lequel, maintenu par une corde et « venant d’amont entre deux poteaux », sépara la tête des épaules du Génois Giustiniani, en 1507, puni pour avoir fomenté une révolte contre Louis XII. Mais c’est l'abbé Jean-Baptiste Labat qui est un des premiers Français à avoir amplement parlé de cette machine peu ordinaire : la « mannaia ». Un des amis de Guillotin a révélé que le médecin aurait formé ses idées d’après un récit similaire mais anonyme : Voyage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne (Francfort ; 1736) où l’on trouve une description précise de cette mannaia.
Labat pourrait être un inspirateur de Louis et de Guillotin car il avait déjà livré de semblables réflexions sur l’instrument : « Cette manière est très sûre et ne fait point languir un patient, que le peu d’adresse d’un exécuteur expose quelquefois à recevoir plusieurs coups avant d’avoir la tête séparée du tronc ». Ce supplice était cependant réservé aux gens de bonne condition. Le supplicié, à genoux, posait son cou sur une traverse. Le couperet était un rectangle de fer aiguisé d’une dizaine de pouces de long et de six de haut, hissé tout en haut par une corde qu’on lâche. C’est probablement cette méthode italienne qui a été imitée dans le Languedoc. Dans les mémoires de Puységur, il est relaté une insolite exécution en 1632, dans la cour du Capitole à Toulouse, qui est celle du duc de Montmorency, condamné, en dépit de ses services, par un Richelieu sans merci, dont il avait tenté d’abattre la puissance. « En ce pays-là, on se sert d’une doloire qui est entre deux morceaux de bois et, quand on a la tête posée sur le bloc, on lâche la corde ».
Une gravure de Giulio Bonasone qui illustre l'exécution du Lacédémonien Lacon, avec une « guillotine » d'ailleurs peu détaillée, figure dans le « Symbolicae quaestiones de universo genere », d’Achille Bocchi, imprimé en 1555.
La Maiden écossaise

Maiden reconstituée sur un socle authentique
L’abbé Joseph de La Porte, dans son « Le Voyageur français » en plusieurs volumes, a décrit un instrument à décapiter qui avait été en usage en Écosse. « […] la noblesse est décapitée d’une manière particulière à ce pays. L’instrument dont on se sert est une pièce de fer carrée, large d’un pied, dont le tranchant est extrêmement affilé […] Au moment de l’exécution, on l’enlève [le hisse] au haut du cadre de bois à dix pieds d’élévation et, dès que le signal est donné et que le criminel a le col sur le billot, l’exécuteur laisse librement tomber la pièce de fer […] ». Le même instrument, si l’on se fie à des gravures, était connu aussi en Irlande.
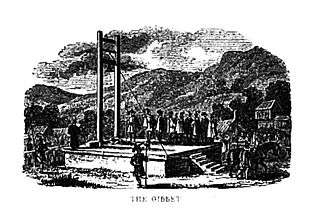
Le gibet d'Halifax
Selon Thomas Pennant, cette machine aurait, à l'origine, été construite par Lord Earl Warren pour faire justice des braconniers de ses terres de Hardwick, près de Halifax. Elle fonctionna de 1541 à 1685 pour une cinquantaine d'exécutions. À l’époque de Pennant, cette machine n’existait plus mais ce « touriste » en vit une copie à Édimbourg en pièce de collection. Elle avait été jadis demandée par le régent Morton qui finit d’ailleurs par l’expérimenter lui-même en 1581. Elle avait dix pieds de haut et l’aspect d’un chevalet de peintre, et le condamné posait la tête sur une traverse à la hauteur de quatre pieds. On retrouve donc ce même principe dans presque toutes les machines à décollation : coulisses, tranchoir aiguisé et mouton pesant hissés par une corde puis relâchés. Cependant, l'héraldiste Randle Holme (en) dans son « Academy of Armoury » de 1678 nous cite une « guillotine antique », mise en blason, où l’on se contentait de poser le tranchoir directement sur le cou du patient ; et le bourreau armé d’une lourde masse frappait un grand coup sur le dos de la hache. Il attribue l’usage de cet engin aux Hébreux et aux Romains. La faible course du couperet sur les machines de certaines gravures illustrant des faits antiques paraît indiquer que les artistes aient pris exemple sur cette machine à « percussion ».
Un opuscule « Halifax and its gibbet law » [Halifax et sa loi du gibet] avait paru en 1708 puis en 1722, que Guillotin pouvait avoir consulté. Mais les ouvrages édités montrent que les coutumes italiennes étaient mieux connues en France. Le docteur Louis explique, de son côté, qu’il s’est inspiré des coutumes anglaises. Or il ne fait pas de doute que tandis que la « Pucelle d’Édimbourg » fut la dernière à avoir fonctionné pour supplicier les marquis d’Argyle, père et fils (en 1661 puis en 1685), l’Angleterre utilisait depuis toujours la hache et le billot. Il est possible qu’au lieu de l’Angleterre proprement dite, Louis voulait parler de la Grande-Bretagne. On ne peut non plus certifier qu’une guillotine était déjà employée en Allemagne car, si au moins deux gravures d’artistes germaniques la représentent, il s’agissait d’illustrer un événement de l’époque romaine.
Le docteur Louis, maître d’ouvrage
Portrait d'Antoine Louis, le chirurgien concepteur de la guillotine
La Consultation motivée du 7 mars 1792
À la suite des votes concernant le code pénal, le comité législatif, sur l’instigation de Guillotin qui, le 3 mars, avait écrit au président de l’Assemblée nationale pour lui demander comment s’exécutera l’article 3, avait donc consulté Antoine Louis, homme de science reconnu, expert médical auprès des tribunaux et secrétaire de l’Académie de chirurgie depuis près de trente ans, sur la machine la plus apte à la décollation sans l’intervention principale de l'homme. L’importante correspondance échangée entre les différents acteurs est une aide essentielle aux historiens. Le 7 mars 1792, Louis dépose auprès de l’Assemblée sa « Consultation motivée sur le mode de décollation nouveau ». Les termes employés sont la réponse apportée aux articles 2 et 3 : « Il est aisé de construire une pareille machine dont l’effet est immanquable ; la décapitation sera faite en un instant, suivant l’esprit et le vœu de la nouvelle loi ».
« Le mode de décollation sera uniforme dans tout l’empire. Le corps du criminel sera couché sur le ventre entre deux poteaux barrés par le haut d’une traverse, d’où l’on fera tomber sur le col une hache convexe au moyen d’une déclique [sic] : le dos de l’instrument sera assez fort et assez lourd pour agir efficacement, comme le mouton qui sert à enfoncer des pilotis et dont la force augmente en fonction de la hauteur dont il tombe ».
Le 20 mars 1792, Carlier, le député de l’Aisne, présente enfin le rapport du Comité législatif sur le mode d’exécution. Le 25, est voté l’article 3, titre 1 de la loi correspondante au projet de la machine à décollation préconisée par Louis, après avoir été adopté le 20 sans discussion. La déjà fameuse machine va pouvoir prendre forme.
La conférence secrète des Tuileries

Les gravures de 1793 montrent une lame en forme de faux, montée en diagonale
Le 2 mars 1792, Antoine Louis, fraîchement investi de la mission de conduire la réalisation de l’instrument pénal, avait été invité aux Tuileries par Louis XVI pour discuter de l’objet du décret que ce dernier avait lui-même sanctionné. Le roi, féru de mécanique, était particulièrement intéressé par un dispositif qui n’avait jamais eu cours dans son royaume. Guillotin qui ne possédait à ce moment-là qu’un des premiers schémas de Schmidt, en avait déjà délibéré avec Sanson. Ces deux hommes vinrent de compagnie se présenter devant le chirurgien et le roi, lequel, pour la circonstance, garda l’incognito, mais que le bourreau dit avoir reconnu. Le monarque, après avoir examiné le dessin, en approuva le principe mais émit la critique qu’une lame « en forme de croissant » était insuffisante pour terminer dans tous les cas une coupe franche. Il est, en effet, difficile de couper une chose résistante (le tronc cervical) simplement en appuyant ; un mouvement de cisaillement est nécessaire, à l’instar de celui de la scie. On donna raison au roi qui saisit alors une plume, corrigea le dessin de la lame et lui donna « une ligne oblique » en disant qu’il faudrait essayer les deux dispositions pour confirmer. Ce à quoi il aurait été procédé à Bicêtre quelques semaines plus tard, selon une tradition qui a parfois été suivie mais jamais corroborée par les dires d’aucun de ces protagonistes.
Cette curieuse histoire semble n’avoir pour origine principale que les « Mémoires des Sanson », réputés apocryphes, édités en 1862, rédigés sous le nom d’« Henri Sanson » et suspects d’arrangements importants. Dans les Mémoires de Sanson, publiés en 1831, le Sanson concerné n’en a jamais soufflé mot, et tous les auteurs et chroniqueurs les plus proches des événements méconnaissent complètement l’anecdote.
On a, d’autre part, assimilé sans doute trop rapidement le « coutelas » - c’est le terme employé dans le décret d’août 1792 - fixé en biais sur son support, avec le couperet trapézoïdal comportant un tranchant en biseau, une amélioration qui serait postérieure car les gravures du temps montrent régulièrement une lame en forme de faux ou doloire - normalement fabriquée par un taillandier, selon le propos de Louis - et ajustée en diagonale. Ce qui suggère que ce modèle fut employé au moins jusqu’à l'automne 1793.
Les instructions du docteur Louis
Le docteur Louis donne ses instructions au charpentier Guidon, le 30 mars 1792.
Instruction du docteur Louis au charpentier Guidon, le 30 mars 1792
Cette machine doit être composée de plusieurs pièces.
1° Deux montants parallèles en bois de chêne de la hauteur de 10 pieds, joints en haut par une traverse et montés solidement sur une sole, avec des contre-fiches de côté et par derrière. Ces deux montants seront, dans l’œuvre, à un pied de distance, et auront six pouces d’épaisseur ; à la face interne de ces montants sera une cannelure longitudinale carrée d’un pouce de profondeur, pour recevoir les oreillons d’un tranchoir. À la partie supérieure de chacun de ces montants, au-dessous de la traverse et dans leur épaisseur, sera placée une poulie de cuivre.
2° Le tranchoir de bonne trempe, de la solidité des meilleurs couperets, fait par un habile taillandier, coupera par sa convexité. Cette lame tranchante aura huit pouces d’étendue transversale et six de hauteur. Le dos de cette lame coupante sera épais comme celui d’une hache ; sous ce dos seront par le forgeron pratiquées des ouvertures pour pouvoir, avec des cerceaux de fer, fixer sur ce dos un poids de trente livres ou plus ; si dans les essais on trouvait convenable de rendre plus lourde la masse de cette espèce de mouton, ce poids sera garni d’un anneau de fer en son milieu. Le tranchoir devant glisser de haut dans les rainures des deux montants, son dos aura un pied en travers, plus deux oreillons carrés d’un pouce de saillie pour entrer dans ces rainures.
3° Une corde, assez forte et d’une longueur suffisante, passera dans l’anneau et soutiendra le tranchoir sous la traverse supérieure ; chaque bout de cette corde sera engagé de dedans en dehors sur la poulie correspondante et sera arrêté extérieurement vers le bas de chaque montant.
4° Le billot de bois sur lequel doit être posé le col du patient, aura huit pouces de haut et quatre pouces d’épaisseur. Sa base aura un pied de largeur, mesure de la distance des deux montants ; une cheville amovible traversera chaque montant et fixera de chaque côté le dit billot par sa base. La partie supérieure de ce billot n’aura que huit pouces de largeur. Elle sera creusée supérieurement d’une gouttière pour recevoir le bord tranchant du couperet convexe. Ainsi, les rainures latérales internes des deux montants ne doivent pas s’étendre plus bas que cette gouttière, afin que le billot ne soit pas coupé par le tranchoir. La partie supérieure du billot sera légèrement échancrée pour loger à l’aise le col du patient.
5° Mais pour assujettir la tête et qu’il ne puisse la relever au moment de l’exécution, il faut qu’un croissant de fer, en manière de fer à cheval, bien arrondi par ses bords, embrasse le col du patient, au haut de la nuque, au niveau de la base du crâne, où finit le cuir chevelu, et que les extrémités de ce croissant assez prolongées soient percées pour être assujetties par un boulon qui traversera la base de la partie supérieure du billot dont l’épaisseur est de quatre pouces. Le patient, couché sur le ventre, aura la poitrine soulevée par ses coudes, et son col sera placé sans gêne dans l’échancrure du billot. Toutes choses bien disposées, l’exécuteur placé derrière la machine pourra réunir les deux bouts de la corde qui soutient le tranchoir, et, les lâchant en même temps, cet instrument tombant de haut, par son poids et l’accélération de la vitesse séparera la tête du tronc, en un clin d’œil.
S’il y avait quelques erreurs dans ces détails, elles seraient faciles à vérifier par le constructeur le moins intelligent.
![Dessin authentique[pas clair] d'une guillotine primitive en situation](https://wiki-gateway.eudic.net/wikipedia_fr/I/m/Dessin_de_la_guillotine_primitive.jpg)
Dessin authentique d'une guillotine primitive en situation
On remarque que Louis y a repris la hauteur de dix pieds que l’on rencontre dans la plupart des récits antérieurs et surtout qu’il a pensé à une lame « à coupe oblique ». Dans une lettre du chirurgien à un confrère, avant les essais de Bicêtre, on apprend que la machine aura finalement une élévation de quatorze pieds. Si la hauteur de chute du couperet est primordiale aux yeux du docteur Louis pour parfaire l’exécution, il n’est pas du tout certain que la qualité d’affûtage de la lame qu’il souhaite soit aussi prépondérante. Autrefois, selon Sanson, les épées s’émoussaient ou cassaient rapidement. C’est ignorer la résistance de l’ossature cervicale d’un sujet tourné face en dessous, qui se rompt plutôt qu’elle ne se coupe. L’examen post-mortem du condamné Danvers, guillotiné le 26 janvier 1909, le donne à penser :« La section faite par le couperet est très haute, en biseau et rasant la base du crâne pour finir au menton. Cette section, très peu nette, ne semble pas avoir été produite par un instrument tranchant mais plutôt par écrasement ». On serait donc assez éloigné de la fameuse sensation du « souffle frais sur la nuque » et plus proche de celle de la pendaison « en estrapade ». Comme le col est étroitement enserré, on comprend également que la lame tende à couper au plus près de la base du crâne, surtout si le supplicié s’agite ; Louis Combes rapporte que la tête de Louis XVI eut « le col déchiqueté et la mâchoire mutilée ».
L’instrument sera sujet à de nombreuses modifications et variantes au fil des années ; mais, en France, après 1870, il a pratiquement acquis sa configuration définitive. Les diverses représentations nous montrent une machine munie d’un couperet trapézoïdal en acier à tranchant biseauté et implantée sur une robuste semelle avec des jambes de force métalliques boulonnées qui la destinaient à fonctionner de plain-pied. L’ensemble pouvait facilement dépasser les 4 mètres de haut et peser la demi-tonne ; le bloc tranchant d’une quarantaine de kilogrammes avait généralement une course avoisinant 2,30 m. Les accessoires changeront aussi de forme, notamment le panier pour recevoir la tête, allant du sac de cuir au panier en osier rempli de son, d’abord garni à l’intérieur de toile cirée puis de parois de zinc, pour ne devenir qu’un simple réceptacle métallique rincé au jet d’eau.
Les maîtres d’œuvre
Le charpentier Guidon

L'échafaud peut comporter une trappe lors des exécutions de groupes. (Ici, neuf émigrés sur la place de l'Hôtel de ville)
Le procureur-général-syndic, Roederer, qui est chargé de superviser la nouvelle méthode légale de mise à mort, demande à Louis de s’adresser au sieur Guidon, charpentier ordinaire du Domaine et de s’entendre avec lui. Le chirurgien, qui lui a transmis toutes ses instructions, se montre, dans son courrier du 30 mars 1792, apparemment satisfait de l’entrevue avec cet artisan. Ces instructions nous donnent les renseignements essentiels sur la description générale de l’instrument primitif. Louis en a affiné presque tous les aspects.
Le charpentier du roi était naturellement le mieux placé pour emporter le marché mais il commet l’erreur de présenter un devis jugé exorbitant qui sera refusé net par le ministre Clavière. La note s’élève à 5 660 livres que Louis transmet à Roederer avec un avis défavorable, quoiqu’il reconnaisse que l’artisan « a bien senti les avantages de la construction la plus soignée ». Guidon a pourtant fait valoir que le prix de la machine fabriquée en plusieurs exemplaires - il est prévu une machine par département - tomberait à moins de 1 500 francs par spécimen. On pense alors que Guidon spécule en prétextant la rareté de trouver des ouvriers qui n’ont pas de préjugé ou de répugnance à travailler sur un instrument de mort. Cette difficulté était réelle puisque Roederer n’en disconvient pas, que Sanson émettra une plainte identique lors de l’embauche de ses aides, et que les différents prestataires de la guillotine demanderont généralement l’anonymat.
Guidon avait cependant inclus dans la totalité de la somme le prix de l’échafaud complet en chêne (enceinte, plateforme, trappe, escaliers…). Il restera néanmoins le fournisseur agréé des bois de justice, c’est-à-dire l’échafaud proprement dit, qui passera à 40 louis pour le département de Paris ; et c’est lui qui sera sollicité, après les premiers essais de décollation à Bicêtre, pour remplacer, en vue de la première exécution pénale, le type habituel d’échafaud qui n’avait pas été jugé assez solide pour supporter le poids de la nouvelle machine.
Il faudra attendre le 25 novembre 1870 pour que le ministre de la Justice, Adolphe Crémieux, supprime l’élévation de la guillotine sur une estrade, afin que cette machine ne soit plus l’occasion d’un « spectacle hideux ». Ce qui fournit alors à la loi le prétexte à réduire considérablement le nombre des exécuteurs et de leurs aides. Il ne restera en fonction que trois exécuteurs et leurs aides : à Paris, en Corse et en Algérie.
Le mécanicien Jean-Tobie Schmidt
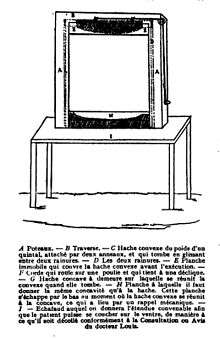
Projet primitif de Schmidt et Laquiante
Louis Du Bois rapporte que c’est un commissaire du roi auprès du tribunal criminel du Bas-Rhin, nommé Jean T. A. Laquiante, qui, dès le mois de février, entre le premier en relation avec Jean-Tobie Schmidt (Usingen, 1768 – Paris, 1821). Schmidt est un mécanicien originaire de la Hesse, installé à Paris depuis 1785 et qui exerce la profession de facteur de clavecins et pianoforte. Enfant des Lumières, comme inventeur, il construisit, entre autres, des cheminées économiques, un gril aérien et un « piano-harmonica ». Un de ses instruments est au Musée de la Révolution française de Vizille (n 38).
Schmidt reçoit donc la proposition de fabriquer la machine dont Laquiante aurait lui-même produit et transmis un croquis inspiré des conceptions du docteur Louis. Mais le projet n’aurait pas été acheminé en temps voulu auprès du ministère de la Justice. Le principe adopté au départ aurait été d’employer deux parties complémentaires, une lame convexe qui tombe pour rejoindre une pièce concave.
Louis, dans une lettre datée du 24 mars 1792, présente lui-même Schmidt à Roederer. Il indique brièvement que dans le projet de ce « machiniste », le patient ne sera ni lié ni couché. Il ajoute que chez Schmidt la coupe est oblique, mais sans autre précision. Le chirurgien avait pressenti le principe d’un tranchant oblique mais en ne parlant, dans sa consultation du 7 mars, que de l’effet de l’arrondi de la lame : « On ne réussirait pas à décapiter d’un seul coup avec une hache ou un couperet dont le tranchant serait en ligne droite ; mais, avec le tranchant convexe, comme aux anciennes haches d’armes, le coup assené n’agirait perpendiculairement qu’au milieu de la portion du cercle ; mais l’instrument en pénétrant dans la continuité des parties qu’il divise, a une action oblique en glissant, et atteint sûrement son but ». Enfin, alors qu'au départ, le bourreau devait tirer sur une corde pour faire tomber le couperet, Schmidt invente un mécanisme plus simple, l'exécuteur n'ayant désormais plus qu'à presser un ressort.
Le 9 avril 1792, Roederer est chargé par le Directoire (il s’agit du Conseil départemental de Paris) de faire construire l’appareil retenu par le législateur. Le premier concurrent, Guidon, éliminé à cause d’un prix trop élevé, c’est Schmidt qui sera le plus rapide à le présenter achevé, très proche des espérances du docteur Louis, et au coût bien inférieur de 824 livres. Schmidt veut déposer un brevet d'invention, mais le ministère de l'intérieur répond : « Il répugne à l'humanité d'accorder un brevet d'invention pour une découverte de cette espèce ; nous n'en sommes pas à un tel excès de barbarie. »
L'architecte Giraud
Dans son rapport d'expertise du 5 juin 1792, l’architecte Giraud a jugé la première réalisation de Schmidt, « faite dans la précipitation » et encore trop peu sûre. Il avait examiné le travail de « l’artiste » et l’avait réévalué, dans son état actuel, à précisément 305 livres, 7 sous et 4 deniers. Ce qui aux yeux du procureur-général-syndic mettait en relief une marge très confortable en faveur du fabricant. Mais le procureur révélera au ministre, deux jours plus tard, que le prototype de Schmidt a été globalement estimé à hauteur de 960 livres, compte tenu du court délai exigé, de la garantie de réussite aux risques du fabricant, des frais de croquis et d’essai et de la remise des guides, plans et dessins. Après l’expertise de Giraud, le prix de la machine enrichie des améliorations conseillées fut fixé, pour les offres publiques suivantes, à seulement 500 livres ; et dès juillet, l’administration exigera que les machines soient désormais livrées peintes. Les guillotines, pour une raison qui se devine, furent recouvertes d’une teinte rouge ou construites avec un bois naturellement rouge.
Extraits du rapport de l’architecte
« Les coulisses, les languettes et les tourillons sont en bois ; les premières devraient être en cuivre, les secondes en fer ; les crochets auxquels sont attachées les cordes qui suspendent le mouton, ne sont retenus que par des clous à tête ronde, ils devraient l’être avec de fortes vis à écrous. Il manque un marchepied à la bascule, les brides sont placées trop bas, ne sont pas assez solides et sont trop ouvertes. Il faudrait avoir en réserve au moins deux moutons garnis de leur couteau, pour remplacer à l’instant celui auquel il pourrait arriver quelque accident. En un mot, si l’on payait à l’auteur une somme de cinq cents livres par machine, pour faire tous ces changements et les fournitures désirées, on ne doit pas douter qu’il s’en chargeât. »
À lire le devis du charpentier, de même que les boulons à tête et écrous, les coulisses en cuivre faisaient déjà partie de sa fabrication. Ces recommandations n’avaient pas d’abord été suivies par un souci d’économie, mais elles furent rendues impératives le 27 juillet où, le bois des rainures ayant gonflé - une guillotine en fonctionnement était, en effet, une machine abondamment graissée et gluante de sang - le cou d’un patient ne fut pas entièrement tranché. Ces incidents ont été surtout reconnus en dehors de Paris, à cause de l'expérience nouvelle des exécuteurs de province. Ainsi, le plus célèbre fut celui de Chalier, qui, ayant dû mettre à son tour la tête au vasistas, eut à recevoir trois fois le couperet qui s’était d’abord arrêté deux fois sur ses cervicales.
Dans une lettre à Roederer du 28 juillet 1792, Schmidt avait vivement réagi aux imperfections qu’on imputait à sa machine et en faisait porter la seule responsabilité aux mauvaises manipulations des utilisateurs. On ne sait si le mécanicien était de bonne ou de mauvaise foi, et si un sursaut de fierté et d’amour-propre ne lui avait pas fait réfuter point par point, avec de bonnes ou de mauvaises raisons, chaque défaut qui avait été révélé de sa machine « à laquelle, écrivait-il, il ne manquait rien ». Quoi qu’il en soit, il ne convainquit personne et on ne tint pas compte de ses objections.
Paternité de l'invention
Roederer, dans un courrier de mi-juillet 1792 au ministre Le Roulx, le renseigne sur la nature du marché conclu avec Schmidt : « M. Schmidt, qui n’avait pas songé à obtenir de brevet d’invention pour une machine dont il n’est effectivement pas l’inventeur, et à laquelle il a seulement fait quelques changements sur la description de M. Louis ; qui avait exécuté celles de Paris, de Versailles et de plusieurs autres départements, et avait fait un traité avec M. Clavière [le précédent ministre], sans concevoir le projet d’obtenir un privilège exclusif indépendant de ce marché, a cru pouvoir en éviter la résiliation en se munissant d’un brevet ». Schmidt, voyant le reste du marché près d’être emporté par des concurrents, tenta de breveter mais il ne put pas aboutir dans cette démarche, d’autant moins que la situation politique était en passe de se compliquer après le 10 août. Comme il refusait le nouveau prix de 500 livres par machine, ses productions antérieures lui furent soldées, en récompense de sa primauté, au prix initial de 812 livres. C’est Clairin, le menuisier de la Cour du Commerce Saint-André, qui produira le premier la machine au nouveau prix.
Antoine Louis, dans son rapport sur les essais, désigne Schmidt comme l’« ingénieur inventeur ». Desgenettes rapporte dans ses mémoires une conversation avec Louis où le chirurgien minimise son rôle dans l'invention de la guillotine : « La part que j'ai prise à cette affaire, que je considère comme un acte d'humanité, s'est bornée à corriger la forme du couperet et à le rendre oblique, pour qu'il pût couper net et atteindre le but. Mes ennemis ont alors essayé, et par voie de la presse la plus licencieuse, de faire donner à la fatale machine le nom de petite Louison, qu'ils ne sont pas cependant parvenus à substituer à celui de guillotine. J'ai eu la faiblesse de me chagriner outre mesure de cette atrocité, car c'en est une, quoiqu'on ait voulu la faire passer pour une plaisanterie de bon goût ».
Pour Sylvain Larue, Antoine Louis est le « réel inventeur » et, de son côté, Yves Pouliquen dit du docteur Louis que la guillotine « sera née de ses mains » car il en a suivi avec attention toutes les péripéties et en a suggéré ou approuvé toutes les modifications.
Le 5 juillet 1792, Schmidt écrit au roi un mémoire afin de solliciter un « brevet d'invention pour une machine à décapiter », accompagné d'un dessin colorié. Le ministre de l'Intérieur Champion de Villeneuve lui fit répondre le 24 juillet : « Il répugne à l'humanité d'accorder un brevet d'invention pour une découverte de cette espèce ; nous n'en sommes pas encore à un tel excès de barbarie. Si M. Schmidt a fait une invention utile dans un genre funeste, comme elle ne peut servir que pour l'exécution des jugements, c'est au gouvernement qu'il doit la proposer. »
La guillotine fonctionnelle
Le berceau de la guillotine
Schmidt, pour mener à bien ce projet de construction, était venu de Strasbourg s’installer à Paris. Son atelier a été situé au milieu de la Cour du Commerce-Saint-André, au 9, dans un appentis qui avait appartenu à une dame Lemor, blanchisseuse. Cette cour, en place d’un ancien jeu de boules de Manus, s’étendait au sud de la rue Saint-André-des-Arts sur laquelle avait son ouverture nord la petite rue de la cour du commerce Saint-André, une allée fermée la nuit par deux grilles (elle sera débouchée en 1823), et composant à l’époque une de ses moitiés et la seule restante de nos jours. Elle communique, au nord-est, avec la cour de Rouen (en réalité, trois courettes qui terminent aujourd’hui la rue du Jardinet). Du carrefour de Buci descend une voie parallèle, la rue de l'Ancienne-Comédie - celle du Café Procope et anciennement rue des Fossés-Saint-Germain. Du côté sud-ouest, c’est un carrefour où convergent la rue de la Liberté (redevenue de nos jours rue Monsieur-le-Prince) et la rue des Cordeliers (aujourd’hui, Rue de l'École-de-Médecine). Le boulevard Saint-Germain qui n’avait pas encore été percé, en a fait disparaître l’autre moitié, au niveau de l’actuelle place Henri-Mondor.
L’adresse était sans doute délibérée puisque Guillotin avait pris un logement dans un bâtiment contigu, au 21, dernier numéro de la rue de l'Ancienne-Comédie. Selon certains auteurs, ce logis aurait, en fait, accueilli le mécanicien collaborateur ; mais Schmidt a désigné lui-même par écrit son domicile : rue Dauphine. Des riverains y furent témoins des essais du futur « glaive de la Loi », car on y procéda à la coupe de bottes de paille puis à la décapitation de moutons afin de juger du bon avancement de l’instrument. C’est dans cette même cour qu’en face, Marat imprima quelque temps son journal. Au-dessus d’un porche qui faisait communiquer la rue des Cordeliers à cette cour, habitait Danton (c’est d’ici qu’il partira pour ne plus revenir) ; à quelques pas au sud, se trouvait le domicile de Marat (au 20 ; aujourd’hui, le 18). C’est là qu’il sera assassiné. Enfin, un tout petit peu plus loin, au 35, logeait Simon, le geôlier du Dauphin. L’« ami du peuple » paraît s’être intéressé à ce que faisait son voisin puisqu’on a pu lui attribuer la première idée de baptiser la machine du nom de « Louisette » afin d’honorer le chirurgien.
Essais sur des cadavres humains

L'hôpital-prison de Bicêtre, à l'époque de la Révolution
Le mardi, 17 avril 1792, se sont retrouvés à Bicêtre dans la cour de la prison, le docteur Louis et ses collègues, à savoir Guillotin et Cullerier médecin-chef de l’hôpital de Bicêtre qui avait réservé des cadavres frais pour l’événement, le mécanicien Schmidt, le charpentier Guidon, l’exécuteur Charles-Henri Sanson, ses deux frères et un de ses fils, probablement Henri, l’aîné, en âge d’exercer comme aide. Il y a aussi des personnalités de l’Assemblée nationale et du conseil des Hospices, ainsi que les médecins renommés, l’aliéniste Pinel et Cabanis. Guillotin fut satisfait et Louis se félicita du succès et fit un rapport en date du 19 avril 1792 à Roederer : « Les expériences de la machine du sieur Schmidt ont été faites mardi à Bicêtre sur trois cadavres qu’elle a décapités si nettement qu’on a été étonné de la force et de la célérité de son action. Les fonctions de l’exécuteur se borneront à pousser la bascule qui permet la chute du mouton portant le tranchoir, après que les valets auront lié le criminel et l’auront mis en situation ». On constate donc que la guillotine est munie maintenant d’une bascule qui immobilise et amène rapidement le corps du patient à l’horizontale et facilite le positionnement de sa tête sur le billot.
D’un autre côté, la version des fameux « Mémoires des Sanson» continue logiquement la réunion des Tuileries : l’expérience aurait été faite avec deux couperets, l’un oblique qui décapita proprement les deux premiers cadavres et l’autre en croissant qui manqua le dernier. Sylvain Larue rapporte une version un peu différente: les cadavres sont ceux de deux prisonniers et d’une prostituée. Le premier corps est coupé avec la lame arrondie. Le coup réussit puis échoue sur le deuxième. La lame oblique parfait la coupe ratée et tranche net le dernier corps, celui de la fille publique.
On a parfois écrit que sur ce même lieu de Bicêtre fut plus tard mise en chantier, une guillotine à neuf tranchants imaginée par un certain Guillot, mécanicien parisien, véritable émule de Schmidt, mais dont la réalisation fut laborieuse et les essais décevants. Cet inventeur fut peu après arrêté pour fabrication de faux-assignats et guillotiné avec la machine officielle.
Première exécution pénale
Elle est enfin prévue pour le 25 avril 1792 en place de Grève. Jamais une machine aussi peu réjouissante n’aura été autant désirée. Entre autres tribunaux qui accumulaient les prisonniers, le deuxième tribunal criminel de Paris avait condamné à mort, trois mois auparavant, le 24 janvier précédent, l’agresseur d’une personne en pleine rue pour lui voler des assignats, nommé Nicolas Jacques Pelletier. Moreau, un juge de ce tribunal, écrit à Roederer :« […] Son crime a été public, la réparation devrait être prompte, et une pareille lenteur, surtout au milieu de cette ville immense, en même temps qu’elle ôte à la loi l’énergie qu’elle doit avoir, compromet la sûreté du citoyen […] ». Roederer s’adresse la veille à La Fayette, commandant-général de la garde nationale pour s’assurer ce jour-là de la main-forte car il pressent que ce nouveau mode d’exécution attirera la foule, et il lui demande en conséquence de laisser sur place les gendarmes plus longtemps après l’exécution, jusqu’à l’enlèvement de la guillotine et de l’échafaud.
Pelletier fut donc le premier homme à être « monté sur mademoiselle ». On nommait ainsi une guillotine qui n’avait pas encore servi. La Chronique de Paris du 26 avril (n°118) signale l’événement :« Hier, à trois heures de l’après-midi, on a mis en usage, pour la première fois, la machine destinée à couper la tête des criminels […] La nouveauté du spectacle avait considérablement grossi la foule de ceux qu’une pitié barbare conduit à ces tristes spectacles ». Si les journaux s’indignent quelque peu, Prudhomme loue l’instrument « qui concilie le mieux ce qu’on doit à l’humanité et ce qu’exige la loi » et il ajoute « du moins tant que la peine capitale ne sera pas abolie ». La foule, restée calme, fut étonnée de la rapidité de l’outil et de son efficacité, mais la majorité des curieux furent déçus de la brièveté du spectacle. Ce que l’on peut résumer par un mot encore prêté à Guillotin : « La tête vole, le sang jaillit, l’homme n’est plus ».
La guillotine, outil insurrectionnel
La fréquence de fonctionnement de la « Veuve », qui avait hérité, selon Ducpétiaux, du surnom de la potence, et qui fut inaugurée en des temps mouvementés, s’imposa rapidement comme le symbole du changement de régime, car l’efficace mécanique se révélera un moyen trop bien rodé à servir un programme d’élimination massive. « On y trouvait une promptitude dont manquaient les anciens supplices ». Ce dispositif devint, au terme de procès souvent expéditifs, un incomparable moyen de mort, si bien que Chateaubriand parlera de « crime légal ». « Cet instrument fait tout, c’est lui qui gouverne », disait Barère qui aurait voulu qu’on construisît des guillotines « à sept fenêtres ». Ce fut tout simplement son âge d’or et elle symbolisa à un si haut degré la dureté de la révolution que les Toulonnais la brûlèrent en place publique pour la punir d’avoir décapité le roi. En avril 1871, elle sera brûlée, pour une toute autre raison, par les Communards, aux cris de « À bas la peine de mort ! ».
Premier tribunal révolutionnaire
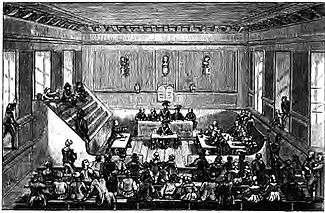
Une séance du tribunal révolutionnaire
On parle généralement de la Journée du 10 août 1792 qui est une conséquence de la peur inspirée par l’ennemi extérieur (le Manifeste de Brunswick) mais rarement de la « Conspiration du 10 août » que les révolutionnaires dénoncèrent dans le même temps et qui amena des exécutions publiques pour l’exemple. De même, on mentionne rarement les procès et l'usage intensif de la guillotine qui s’ensuivirent. Un tribunal exceptionnel fut spécialement créé le 17 mai 1792. Les Archives révolutionnaires et des chroniqueurs nous en ont conservé les péripéties. De cette période datent les premières exécutions politiques, sans même qu’il y ait eu une rivalité déclarée. La presse « […] attise le soupçon d’une lenteur criminelle des juges. Elle diffuse les images d’une capitale désertée par les volontaires, où les comploteurs des prisons se répandront par les rues, égorgeront les patriotes […] Ainsi, écrit Fréron, dans l’Orateur du peuple : « Quand la loi est sourde et muette, les citoyens doivent agir avec transport ».
Premières victimes
Collenot d'Angremont, arrêté à Sèvres où il s’était réfugié avec sa famille, déjà soupçonné d’avoir été l’instigateur d’un assassinat contre le maire Pétion et accusé de conspiration antirévolutionnaire, fut amené, le 21 août, de sa prison de l’Abbaye devant le tribunal révolutionnaire, présidé par Charles Sepher. Il y fut déclaré coupable « d’embauchage et de levée d’individus formés en brigades, en qualité d’agent d’un ministère corrompu et de la police de Paris, ayant entretenu des correspondances suspectes » et condamné à la peine de mort, au terme d’une audience de quelque trente-deux heures. On précipita l’exécution de la sentence pour bénéficier pleinement de l’excitation populaire.
H.A. Wallon rapporte que Charles-Henri Sanson était, sur une initiative du publiciste jacobin Gorsas qui conservait quelque animosité à l’encontre du bourreau, emprisonné par la Commune depuis ce même jour du 10 août afin qu’en cas d’échec de l’insurrection, il n’eût pas possibilité de pendre des patriotes. Il eut un droit de sortie pour les deux premières exécutions et n’aurait été relaxé qu’à la suivante. Le 21 août, à 10 heures du soir, Collenot est conduit place du Carrousel. Le peuple, en chemin, lui arracha sa « redingote nationale » et battit des mains quand il monta à l’échafaud. Sa tête sanglante fut montrée à la lueur des flambeaux dans le silence d’une foule extasiée. Collenot est connu comme le premier guillotiné pour ses opinions politiques.
La guillotine est déclarée permanente
Le 21 août 1792, la guillotine est déclarée permanente
Manuel, procureur de la Commune de Paris, après le supplice, interdit le démontage traditionnel de la machine et, congédiant Sanson qui s’apprêtait à le faire, déclara « la guillotine permanente ». Peu après, s’ensuivit un arrêté de la Commune : « Le procureur de la Commune entendu [Manuel], le Conseil Général arrête que la guillotine restera dressée sur la place du Carrousel, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, à l’exception toutefois du coutelas que l’exécuteur des hautes œuvres sera autorisé d’enlever après chaque exécution ». Ainsi, sur cette place auront lieu presque toutes les exécutions jusqu’au décret du 10 mai 1793 qui désignera pour la remplacer la place de la Révolution, anciennement place Louis XV.
Le 23 août, Arnaud de Laporte, intendant de la Liste civile, arrêté pour avoir réglé les frais de la propagande du parti de la Cour contre les Jacobins fut, au terme d’un procès embarrassé de quelque 40 heures, condamné à mort et décapité le lendemain. Le 25 août, Farmian du Rozoy, publiciste « réactionnaire » à la Gazette de Paris, fut mené à l’échafaud le jour suivant son procès. Il fut enregistré que le prévenu incita l’Assemblée à abolir la peine de mort et à se servir de son sang pour l’expérimenter sur des vieillards afin de vérifier la possibilité d’une régénérescence par l’apport d’un sang nouveau. Ce qui en fait probablement le premier exemple reconnu d’un corps laissé à la science. Il est aussi le premier à avoir été guillotiné pour ses écrits politiques. Le Bulletin du Tribunal reconnut le courage de ce personnage : « Nous regrettons seulement que des hommes de sa trempe n’embrassent point la cause de l’humanité ».
Jean Julien, charretier de Vaugirard, fut pris lui aussi au nombre des conspirateurs du Dix-Août et condamné, pour l’exemple, à dix ans de pilori en place de Grève. Son supplice commença le 1 septembre. Le malheureux se mit à invectiver la foule qui venait le voir. Sans cesse, il criait « Vive le roi, vive la reine ! » et insultait la Nation qui l’avait condamné. La populace l’aurait mis à mal s'il n'avait été ramené en prison. Le lendemain, il fut jugé, condamné à la peine capitale, puis décapité le jour suivant. Le mot qui définit le mieux cette triste histoire est celui du président du tribunal Osselin dans son allocution finale: « Vous étiez condamné à un esclavage de dix ans [...] un esclavage de dix ans pour un Français est une mort continuelle ».
Le 2 septembre, le major des Gardes suisses, nommé Bachmann, dont le procès avait commencé la veille, et durait depuis trente-six heures, avait vainement invoqué l’incompétence du tribunal révolutionnaire, étant donné qu’il était étranger et que son pays avait ses propres tribunaux pour le juger. Pendant qu’on l’interrogeait, une troupe de justiciers ensanglantés qui revenaient des prisons de la Conciergerie fit irruption pendant l’audience pour assouvir les « vengeances du peuple ». Le major Bachmann s’avança vers la barre et demanda à être le seul coupable, afin que ses compatriotes présents dans la salle fussent épargnés. Le président Lavaux, gardant le même calme autoritaire que le Suisse, obtint de la cohorte qu’elle respecte la loi et se retire. Le garde qui avait, pour ainsi dire, prononcé sa propre sentence, fut condamné à mort et exécuté le jour même.
Second tribunal révolutionnaire
Le nombre considérable des prisonniers incriminés comme les « ennemis intérieurs » de la Révolution et la lenteur de leurs procès furent un des motifs qui, à cette période, ont incité à une justice parallèle plus expéditive, laissant les mains libres à « la justice du peuple » : les massacres de Septembre. Le premier tribunal révolutionnaire fut brutalement dissous le 1 décembre 1792 et, les massacres ayant pour ainsi dire pris le relais, l’échafaud tomba ensuite dans l’inaction complète pendant près de quatre mois, sinon pour les exécutions de droit commun ou exceptionnelles comme celle du dernier souverain ; ce qui laisse supposer des luttes fratricides au sein des factions jacobine et girondine en vue de prendre la tête du mouvement insurrectionnel. Cela se termina avec la prise de commande par les Jacobins qui eurent à remettre tout de suite en marche la guillotine et instituèrent le 10 mars 1793 un second tribunal criminel extraordinaire qui, le 28 octobre 1793, prendra officiellement, cette fois-ci, le nom de « tribunal révolutionnaire » et auquel furent conférés « une juridiction illimitée et des pouvoirs exorbitants ».
« Soyons terribles pour dispenser le peuple de l’être », s’exclame Danton au cours des débats. Robespierre, de son côté, écrit sans ambages : « La Terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible : elle est donc une émanation de la vertu ». Le premier exécuté de ce tribunal est Louis Guyot des Maulans, gentilhomme poitevin, arrêté le 12 décembre 1792. Jugé le 6 avril suivant, il fut exécuté ce même jour, et, comme l’heure était tardive, à la lueur de quatre douzaines de flambeaux, recréant la magie nocturne des premières décapitations politiques. Mais c’est le parti des Girondins qui fera principalement les frais de cette recrudescence. La loi de modification de ce tribunal en date du 10 juin 1794 (22 prairial, an 2) va simplifier et donc accélérer les procédures. Cette loi fut impopulaire et les députés de la Plaine demandèrent instamment qu’elle fût rapportée. Le tribunal qui avait prononcé 1231 condamnations à mort du 6 avril 1793 au 10 juin 1794 en a prononcé 1376 du 11 juin 1794 au 27 juillet 1794. « La sévérité n’est redoutable que pour les ennemis de la liberté », déclare encore Robespierre à propos de la Loi du 22 Prairial.
Sur les 500 000 emprisonnés au cours de la Révolution, 100 000 ont été exécutés ou massacrés. 20 à 30 000 fusillés et sur les 17 000 guillotinés de la Terreur, 85 % des condamnés étaient issus du tiers-État (essentiellement des bourgeois), 8,5 % de la noblesse et 6,5 % du clergé.
Les hommes de la guillotine
Charles-Henri Sanson, un maître exécuteur

L'exécuteur des hautes œuvres du roi Louis XVI (Charles-Henri Sanson, lui-même, imaginé par H. Baron)

Une exécution place de la Révolution.
Un certain Giraud, dans une lettre au Comité de salut public, s’exclame :« À Paris […] l’art de guillotiner a acquis la dernière perfection. Sanson et ses élèves guillotinent avec tant de prestesse qu’on croirait qu’ils ont pris des leçons de Comus, à la manière dont ils escamotent leur homme ! ». Si Sanson fut « l’exécuteur des hautes-œuvres » sous l’Ancien régime, il devint populairement le « Vengeur du peuple » sous la Terreur, ou plus familièrement le « barbier national » ; mais, publiquement, il n’était pas question de l’appeler guère autrement que « l’exécuteur des jugements criminels ». Camille Desmoulins, entre autres, qui le surnomma par la suite « le chef du pouvoir exécutif », en avait subi les conséquences quand il l’avait, dans son journal, traité de « bourreau », car il se vit assigné pour calomnie devant les tribunaux par le chatouilleux guillotineur. Une ordonnance du Conseil d’État, en date du 12 janvier 1787, avait rappelé, en effet, qu’était proscrite l’appellation de « bourreau » pour nommer l’exécuteur des hautes œuvres.
Comptant quelques inimitiés, il fut amené à défendre son honneur quand il fut accusé de faire commerce des dépouilles des suppliciés, et notamment celles de « Louis Capet ». Il écrivit une réponse dans « Le Thermomètre du jour » : « […] ce commerce infâme ne peut avoir eu lieu que par des fripons ; la vérité est que je n’ai pas souffert que personne de chez moi en emportât ou en prît le plus léger vestige ». Il usa encore de son droit de réponse dans le même journal pour « rendre hommage à la vérité » quand un article virulent de l'antimonarchiste Dulaure lui prêta des propos qu’il n’avait pas tenus sur la mort du dernier roi. Sanson qui était bien placé pour avoir vu mourir ce dernier avec « un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonnés » décrivit avec précision tous les faits et gestes du roi à sa dernière heure. Dulaure dut se rétracter et révéler sa source qui n’était autre que les Annales patriotiques et littéraires de Carra qui exécrait Louis XVI autant que lui et décrivait le souverain comme un lâche. Sanson avait beau être le précieux auxiliaire de la nation, on ne lui épargnait rien. Ainsi, lorsque la tête de Corday fut souffletée, le conventionnel Sergent-Marceau demanda au président du Tribunal un blâme à l’encontre de l’exécuteur. Or, s’il était logique de le soupçonner, Sanson put établir qu’on devait imputer cet acte à un charpentier qui n’était pas à son service et qui avait reconnu sa faute.
Le maître-exécuteur qui voyait pourtant son action facilitée, s’étonnait du nombre de condamnés et fut un temps soupçonné de modération, car il montrait un calme résigné, voire de la sollicitude envers les suppliciés comme envers le roi. Partisan discret de l’abolition de la peine de mort, il eut l’occasion de sauver quelques femmes auxquelles il avait conseillé de se déclarer enceintes. On détenait, en effet, ces femmes jusqu’à la preuve de leur grossesse, à la prison de la Petite-Force, ancien hôtel de Brienne qui jouxtait l’hôtel de la Force. Un autre trait marquant qui lui valut l’estime des chroniqueurs est l’intervention risquée de Sanson auprès de Fouquier-Tinville pour ajourner une charrette de condamnés qu’il pensait menacée par une inquiétante agitation populaire. C’était le 9 Thermidor, et si l’accusateur public qui ne se souciait à cette heure que d’aller manger, n’était pas resté inflexible, les malheureux auraient été sauvés. Comme le souligne G. Lenotre, Sanson fut impertinent, ne craignant ni de critiquer ni de réclamer, mais il demeurait « l'agent nécessaire, indispensable, le plus ferme soutien du régime en vigueur, la base de tout le système [...] et s'il n'eût été le guillotineur, il eût été guillotiné ».
Sanson, avait, en des temps difficiles, assumé une tâche délicate ou plutôt toutes celles qui incombent à un bourreau, en incluant toutes les autres punitions qui sont décrétées par un tribunal, avec une conscience irréprochable et fut un exemple pour tous ses collègues des autres départements. Les plaintes furent rares : parfois des spectateurs furent indignés et accusèrent un de ses aides d’avoir saisi et maîtrisé trop rudement des condamnés récalcitrants. On appela aussi la guillotine « la fille à Charlot » car Charles-Henri Sanson est resté dans les mémoires pour avoir suivi les tout premiers coups de lame de cette machine et « raccourci » la plupart des protagonistes politiques de son époque. Las de cette tâche dont il s’est dégoûté assez vite, il apparaît, à un certain moment, avoir laissé son fils aîné, d’un âge où on est moins sentimental, commander les exécutions à sa place. Il devait se retirer le 30 août 1795, à l’âge de cinquante-six ans, après un exercice titulaire de 17 ans. Il était entré, en effet, dans le métier une vingtaine d’années auparavant. Le 13 septembre 1790, il avait déjà désigné officiellement comme successeur son fils Henri qui était alors capitaine d’artillerie.
Le traitement des exécuteurs
Il est établi par le décret du 13 juin 1793 dont voici les premiers articles :
« article 1 : - Il y aura dans chacun des départements de la République, près des tribunaux criminels, un exécuteur de leurs jugements. article 2 : - Le traitement des exécuteurs est une charge générale de l’État. article 3 : - Dans les villes dont la population n’excède pas 50 000 âmes, il sera de 2 400 livres. Dans celles dont la population est de 50 à 100 000 âmes, de 4 000 livres. Dans celles de 100 à 300 000 âmes, de 6 000 livres. Enfin, à Paris, le traitement de l’exécuteur sera de 10 000 livres. »
Sous le règne de Louis-Philippe, le bourreau de Paris touche annuellement 8 000 francs, celui de Lyon, 5 000 et 4 000 dans des villes comme Rouen, Bordeaux et Toulouse. Les localités de moins de 50 000 habitants reçoivent 2 400 francs. Charles Sanson eut, dans le département de Paris, un travail intense durant les années où il officia. Ainsi, il reçut 1 000 livres supplémentaires pour chacun de ses aides (il en avait régulièrement quatre) et une indemnité annuelle de 3 000 livres pour compenser la période exceptionnelle qu’il rencontra.
Mais il apparaît nettement que l’administration n’avait pas évalué ses frais avec assez de réalisme, car nous conservons de Sanson des demandes réitérées d’augmentation auprès de Roederer : « Le mode d’exécution qui se pratique aujourd’hui triple aisément les frais de dépenses anciennes, en outre du renchérissement de toutes les choses nécessaires à la vie […] Il me faut du monde sûr car le public veut de la décence. C’est moi qui paie cela. Pour avoir du monde comme il le faut pour cet ouvrage, ils [les employés] veulent des gages doubles des autres années antérieures […] Il faut alors pour s’en procurer les enchaîner par l’appât du gain […] J’ai quatorze personnes tous les jours à nourrir, dont huit sont à gages, trois chevaux, trois charretiers, les accessoires… Un loyer énorme à raison de l’État (de tous temps, l’exécuteur a toujours été logé par le roi) ».
Fouquier-Tinville, la Hache personnifiée
Aucun acteur révolutionnaire n’aura autant symbolisé, voire incarné la guillotine que Fouquier-Tinville. Sous la monarchie, sa passion du jeu avait fait péricliter ses affaires mais, en bon opportuniste, Fouquier - il signait de ce seul nom – va prendre sous la Terreur, une fois mué en accusateur public, une belle revanche de parvenu. Il griffonne à la hâte des noms à peine lisibles, passe outre les confusions de noms, abrège les plaidoyers et, sans cesse, il arrête, accuse, emprisonne et fait monter sur la charrette des individus dont il ne connaît rien la plupart du temps mais dont on lui a dit assez de mal. Il veut installer la guillotine dans la salle même des audiences pour que les sentences puissent être exécutées plus vite mais le Comité de salut public le fait renoncer à cette idée. Coupables et innocents avaient à ses yeux la même tête. Louis Blanc dit de lui : « Sa voix rude passait soudain de l’aigu au grave : elle avait pour les accusés le son de la hache sur le billot ». Les auteurs, notamment les « réactionnaires », ne l’ont pas épargné mais il était difficile de lui trouver un aspect qui fût présentable : « […] au début, magistrat laborieux et instruit, point trop rigoureux, tant qu’une modération relative demeura à l’ordre du jour. C’est la bassesse d’âme et la servilité de son zèle professionnel qui, dans la suite, le rendirent implacable et cruel ».

Fouquier-Tinville, guillotiné le 18 floréal an III. « Je n’ai été que la hache de la Convention : punit-on la hache ? »
Ordre d'exécution signé de Fouquier contre Manon Roland et Lamarche, ex-directeur de la fabrique des assignats.
L’accusateur officia comme si c’était « leurs têtes ou la sienne ». Pas plus qu’on a pu formellement l’accuser de s’être enrichi, on n’a pu l’accuser d’une franche perversité ; mais on a relevé des faits troublants. Fouquier dénombrait par avance les condamnés avant même le début de leur procès, et s’en tenait à ce chiffre. Il n’hésitait pas non plus à faire rappeler une femme qui s’était déclarée enceinte pour « faire le nombre » sur la charrette, aussi simplement que ce fils de paysan aurait ajouté une botte de paille pour caler un chargement. Cabanès et Nass ont tenté de sonder son psychisme inquiétant : « […] il aimait le spectacle des guillotinades, surtout lorsque c’était le tour des belles et jeunes femmes. […] C’était une âpre volupté pour l’homme rouge de voir tomber dans le panier ces têtes charmantes et leur sang vermeil ruisseler sous le hideux couperet ». De fait, il conduisit à la guillotine la majorité des viragos, des vestales et des égéries de la Terreur. Quand vint le temps où l’on pensa à suspendre le bras de celui qui ne pensait qu’à faire « raccourcir », l’accusateur public, constamment sûr de sa bonne conscience et de son efficacité au service de la nation, a pu très bien avoir déclaré devant le tribunal ces paroles qui lui sont attribuées et qui le résument si bien :« Je n’étais que la hache dont on se servait, on ne peut pas faire de procès à la hache ! ».
Fouquier fut un être véritablement envoûté par la guillotine et vécut entre deux mondes qu’on aurait cru inconciliables : son office public glacial et impitoyable où il trouve son contentement quand, selon sa propre expression, « les têtes tombent comme des ardoises par un grand vent », et son foyer familial chaleureux et discret. On soupçonne facilement qu’il appartienne à ce type de bourreau sanguinaire qui revient paisiblement auprès des siens, la conscience satisfaite d’avoir rempli exactement sa mission et même un peu plus. Le 7 mai 1795, il monta sur la charrette avec tristesse et morgue pour aller à son tour « éternuer dans le sac » ; il n’avait plus que des ennemis et pas un remords. On pourra s’interroger longtemps pour déterminer si c’est le ton qui sollicitait l’excuse ou qui exhalait la lassitude, avec lequel on l’entendit lancer un jour à la serveuse de la buvette de l’Assemblée où il avait ses habitudes : « J’aimerais mieux être laboureur ! »
L’extrait de la dernière lettre écrite en adieu à sa femme par ce veuf remarié qui fit huit enfants (cinq survécurent) laisse incrédule, s’il n’était sa signature, tant elle semble insolite sous la plume d’un homme qui détruisit sans sourciller des familles entières et qui conservait, mais seulement pour lui-même et son clan, la sensiblerie de son époque : « Je mourrai donc pour avoir servi mon pays avec trop de zèle et d’activité […] Mais ma bonne amie, que vas-tu devenir, toi et mes pauvres enfants ? […] J’étais donc né pour le malheur ! […] Oublie les petits différends que nous pouvons avoir eus ; ils ont été l’effet de ma vivacité ; mon cœur n’y est pour rien et il n’a jamais cessé de t’être attaché […] Les larmes aux yeux et le cœur serré, je te dis adieu, à ta tante et à nos pauvres enfants. Je vous embrasse tous, je t’embrasse mille fois. Hélas ! Quelle douce satisfaction n’éprouverais-je pas de pouvoir te revoir et te presser dans mes bras ! […] Embrasse bien nos enfants et ta tante pour moi ; sers de mère à mes enfants [ceux du premier lit] que j’exhorte à la sagesse et à t’écouter. Adieu, adieu, ton fidèle mari jusqu’au dernier soupir ».
Les Tricoteuses
Le 30 octobre 1793, un décret de Jean-Pierre Amar interdit les clubs et les sociétés de femmes « sous quelque dénomination que ce soit ». Rose Lacombe, chef de file de la société des Femmes révolutionnaires, proteste et, le 17 novembre, à la tête d’un groupe de compagnes coiffées du bonnet rouge, envahit le Conseil général de la Commune. On décide, pour ramener le calme, par le décret du 26 décembre suivant, de mettre à l’honneur le rôle valeureux des « citoyennes patriotes des 5 et 6 octobre, en leur accordant des « places marquées », lors des « cérémonies civiques » (les exécutions capitales sont donc comprises) ainsi qu’à leurs époux et leurs progénitures, et l’autorisation d’y tricoter. Ces femmes devaient passer dans l’histoire révolutionnaire comme les tricoteuses. Si on suppose que le mot devait faire partie du langage courant, on ne le trouve pourtant écrit la première fois que dans « L’Ami du peuple » de Lebois, du 17 janvier 1795, et ce terme devenu rapidement injurieux fut donné à toutes celles qui se montraient d’ardentes partisanes de la manière forte.
Femmes de la halle
Les Fouetteuses
Furies de guillotine
« Ce fut des échoppes de la halle que sortirent la plupart des héroïnes d’octobre, et plus d’une furie de guillotine fut recrutée sous les parasols du marché des Innocents ». Les divers récits de l’époque nous font apparaître qu’il est guère aisé, en effet, de différencier de toutes ces patriotes qui s’agitèrent dans les assemblées, les rues, les places et spécialement autour des échafauds, les paisibles mères de famille qui pouvaient se transformer en un moment en de terribles passionarias. Le comédien Fleury avait sa méthode pour les reconnaître : « Si elles étaient vieilles, on les appelait tricoteuses ; si elles étaient jeunes, elles avaient nom furies de guillotine ». On a prétendu qu’on avait libéré de prison des femmes de mauvaise vie afin de grossir les rangs de ces tumultueuses « jacobines », et même que des hommes se travestissaient en femmes pour se mêler parmi elles et jouer le rôle de meneurs. « [des charrettes] chargées de condamnés et suivies, avec des cris insultants, des chansons atroces, par des femmes hideuses, qu’on appelait furies de la guillotine ». On vit des flagelleuses remettre férocement dans le bon chemin les mauvaises citoyennes, comme celles qui ne portaient pas la cocarde obligatoire. Ces matrones assistaient aux délibérations de la Convention, huaient les déclarations trop prudentes et applaudissaient aux discours virulents, notamment ceux de Robespierre, leur idole. On les apercevait régulièrement tricoter autour de l’échafaud – certaines y auraient loué des chaises - et attendre patiemment l’heure d’ouverture du théâtre sanglant de la bascule à Charlot. Elles excitent la populace, invectivent les condamnés des charrettes, ponctuent la chute du couperet et se réjouissent des grimaces des suppliciés. Leur zèle et leur assiduité leur attirèrent une autre dénomination : les lécheuses de guillotine.
Il est sûr que le fanatisme de ces femmes a été largement amplifié par des plumes vengeresses ; mais les rapports de police du début de 1794 sont également éloquents : « Il est étonnant [de voir] à quel point les femmes sont devenues féroces ; elles assistent tous les jours aux exécutions » ; ou encore : « Le peuple dit que les femmes étaient devenues sanguinaires, qu'elles ne prêchent que le sang, qu'il y a, entre autres, une certaine quantité de femmes qui ne quittent point la guillotine, ni le tribunal révolutionnaire ». Leurs excès finirent par provoquer l’exaspération des politiques. Le lendemain de la mort de Féraud, massacré pendant que la salle de la Convention est envahie par des manifestants, les femmes qui y avaient pris une part active - on a rapporté que, dans la cohue, la célèbre Aspasie Carlemigelli avait, involontairement ou non, piétiné le député - sont exclues des tribunes par le décret du 21 mai 1795, et, le 23, un autre les exclut des assemblées politiques et leur interdit les attroupements.
La guillotine « ultima ratio »
Le chien de garde de la Révolution
Cette devise serait due à Pache, quand il était maire de Paris
Couthon déclamait cette sentence : « Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le moment de les reconnaître ». La guillotine, véritable épouvantail, servit non seulement d’instrument d’éradication d’ennemis réels ou supposés mais aussi de garantie pour toutes les décisions politiques et économiques du gouvernement révolutionnaire. Les armées de sans-culotte levées dans l’urgence pour réprimer les soulèvements de province partaient battre la campagne, toujours suivies d’une « guillotine ambulante ». Elle concrétisa la peur du gendarme mais favorisa aussi tous les excès auxquels on peut s’attendre dans un pays mis en coupe réglée.
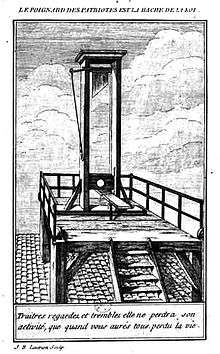
Affiche menaçant de la guillotine
Robespierre caricaturé : ne trouvant plus personne à guillotiner, il guillotine le bourreau
Vadier déclarait justement : « Coupons des têtes, nous avons besoin d’argent, ce sont des confiscations indispensables ». On ne peut plus s’étonner qu’on appelât aussi la guillotine la « planche à assignats » quand on entend encore la belle tirade d’Hébert s’aidant de la rhétorique la plus percutante : « […] si nos paroles sont méconnues, qu’ils se rappellent la puissance magique de la guillotine ; qu’ils sachent qu’avec la guillotine nous ferons mettre les pouces aux accapareurs ; qu’avec la guillotine on fait de l’or ; qu’avec la guillotine on fait sortir le numéraire des caves ; qu’avec la guillotine nous ferons disparaître les traîtres ; qu’avec la guillotine nous ferons tomber la calotte ; qu’avec la guillotine, enfin, nous ferons taire les mécontents, que nous aurons du pain… ». Hébert parlait sans doute en connaissance de cause, car un nommé Denoui, envoyé en mission de Paris à Angoulême avait « fait mettre la guillotine en permanence sur la place publique avec cette inscription : « Avis aux meuniers et boulangers ». Prudhomme ajoute : « Ces messieurs ont profité de l’avis et la famine a disparu ».
Le girondin Pétion avait écrit, peu avant son suicide, un article pamphlétaire contre la Montagne, où il dénonçait l’usage outrancier de la guillotine. « ont la tête tranchée : le particulier qui se met de côté un excédent de grain ; le commerçant dont l’inventaire est inexact ; les domestiques et les cochers qui parlent de royauté… » Un véritable service d’agents secrets, nommés les « observateurs de l’esprit public », se mêlent à la population et font des rapports sur toutes les actions ou conversations déviantes ; et des « moutons » sont placés dans les prisons. Il est, donc, à ce moment-là de la Terreur, difficile de reconnaître dans la machine punitive un instrument de justice, et Guillotin aurait frémi s’il avait pu lire la lettre qu’adressait Alexandre de Beauharnais à sa bientôt veuve Joséphine : « Dans les orages révolutionnaires, un grand peuple qui combat pour pulvériser ses fers doit s’environner d’une juste méfiance et plus craindre d’oublier un coupable que de frapper un innocent ». Pétion, dans le même article, donnait, en quelque sorte, une conclusion : « Sous le régime soi-disant républicain, cette peine s’est tellement étendue que les législateurs actuels en ont fait le principal ressort de leur gouvernement […] O législateurs barbares ! Jusqu’à quel point vous avez dépravé la morale du peuple ».
La machine à couper les têtes est si rapidement entrée dans les mœurs qu’elle incitait à une justice populaire expéditive, un réflexe de lynchage qui, depuis les pendaisons A la lanterne, perdurait sous le Directoire. Ainsi, un jour de 1797, après le spectacle d’une exécution publique, un garçon perruquier fut surpris au moment où il venait de subtiliser une montre dans la cohue. Il est maîtrisé rapidement et un mouvement de colère s’empare de la foule qui veut immédiatement lui couper la tête, le traîne à l’échafaud encore dressé, le hisse sur le tréteau, le couche sur la planche à bascule et lui immobilise le col sous le couteau, selon une procédure qu’ils ont vue de nombreuses fois. Heureusement pour le voleur, le tranchoir est cadenassé par précaution et Sanson qui se délasse dans un cabaret voisin, ne se fera pas reconnaître et n’aura pas à donner les clés. Le garçon en fut quitte pour avoir été immobilisé plusieurs heures dans une position angoissante avant d’être délivré.
La purge des armées
Custine au pied de l’échafaud
L’ombre funeste de la machine se dresse également pour dissuader les généraux, presque tous d’une ancienne noblesse et « restés aux armées par habitude du métier » mais, par principe, tous suspects d’un coup de force ou d’un ralliement à l’ennemi ; crainte avivée par la défection récente de Dumouriez et par les menaces des phalanges étrangères aux portes de la nation. Il s’installa dans le gouvernement une suspicion mutuelle digne d’une guerre psychologique. « La trahison semblait être partout. Chaque chef de corps devenait suspect ». Le ministre de la guerre, Bouchotte, aux prises avec des chefs militaires, fait inonder les troupes de journaux révolutionnaires qui prennent les chefs à partie, pour « empêcher les soldats de s’engouer de leurs généraux ». Dans ce climat tendu, la Convention se révèle d’une féroce brutalité pour mettre au pas les différentes armées. Mais elle va constituer peu à peu une force militaire d’une grande cohésion que cimentera une conviction républicaine sans faille. Ces unités de combat seront prêtes à parcourir, pendant des années, l’Europe entière pour défendre la nation et les idées nouvelles.
Desaix, Marceau, Kléber, Lecourbe, Hoche inspirent la méfiance. Tous les officiers complices de Dumouriez fournissent les premières charrettes de militaires à la guillotine ; puis le principe de précaution punira de plus innocents, tels Custine et Biron, seulement répréhensibles de rechercher quelque gloire, c'est-à-dire soupçonnés « d’ambition et d’incivisme ». Subiront le même sort Beauharnais pour avoir laissé son armée se reposer deux semaines et, du même coup, avoir contribué à la perte de Mayence ; Houchard pour n’avoir pas poursuivi l’ennemi après le succès de la bataille de Hondschoote ; et le général De Marcé, vaincu en mars et en avril 1793 en Vendée, sous l’accusation d’avoir ainsi favorisé la chouannerie. La Convention aura guillotiné pas moins de vingt-cinq généraux.
Les hauts lieux de la guillotine
La voie funèbre
L’arcade sombre à droite du perron de la Cour du Mai, « c’était par là qu’à l’époque révolutionnaire on entrait à la Conciergerie et qu’on en sortait…. »
Conciergerie : au bout d'un long corridor, un escalier obscur, appelé la rue de Paris, conduisait au tribunal.
À la sortie, une charrette attendait les condamnés dans la Cour du Mai.
Le parcours commençait toujours par le passage du Pont au Change.
Erreur de référence : Des balises <ref> existent pour un groupe nommé « note », mais aucune balise <references group="note"/> correspondante n’a été trouvée, ou bien une balise fermante </ref> manque.
Le trajet le plus connu est celui que la justice appelait la « route ordinaire », depuis le tribunal (Conciergerie) jusqu’à l’ancienne place Louis XV. La durée est variable selon l’heure, le climat, les spectateurs et l’importance du cortège. Il dure environ trois-quarts d'heure à une heure et demie ; près de deux heures pour le roi qui voyagea dans la voiture de Clavière, depuis sa prison du Temple, précédé de canons roulants, de tambours et de quelques milliers de soldats. Les charrettes à ridelles, appelées par dérision « carrosses à trente-six portières », sont à la mesure des personnes à transporter. On peut y voir dix, quinze, trente personnes et « enfin jusqu’à quatre-vingt-quatre » nous dit H.J. Riouffe. Le convoi peut comporter plusieurs charrettes selon l’importance de la « fournée ». Normalement Sanson en possède deux mais il doit souvent en louer des supplémentaires qui lui coûtent 20 francs sur ses deniers, dont 5 francs de pourboire, car les conducteurs comme les loueurs sont d’autant plus réticents qu’après une longue série de décapitations, les paniers ne peuvent suffire et les corps sont entassés à même la charrette pour être transportés jusqu’à la fosse du cimetière.
Les condamnés, ceux qui ont été jugés avant une heure trop tardive, cheveux raccourcis, poings liés dans le dos, sortent dans la cour du tribunal, la Cour du mai. Les charrettes y stationnent déjà toutes prêtes et se mettent en marche sur un signal de Sanson. Tout de suite dehors, c’est une petite place semi-circulaire très animée où s’est installé le débit de tabac très fréquenté de la mère Guibal. Le convoi qui assure le spectacle emprunte le pont au Change, escorté de gendarmes à cheval et de gardes nationaux ; il vire à gauche sur le quai de la Mégisserie, dévie au carrefour des Trois-Maries, pour suivre la rue de la Monnaie puis celle du Roule pour ensuite tourner à gauche, sur la longue rue Honoré (rue Saint-Honoré). Les Halles voisines attirent au virage un afflux de badauds qui provoque régulièrement un énorme encombrement. La rue Saint-Honoré est préférée, chaque fois qu’il est possible, au quai des Tuileries, plus direct mais sans population, et permet ainsi au plus grand nombre, à tous les étages – les fenêtres se louent à bon prix - d’assister au passage des condamnés qu’ils auront tout le temps de vilipender, de conspuer, de couvrir d’horions et de crachats, chantant et hurlant des obscénités. Les commerces sont contraints de fermer, les crieurs précèdent et annoncent la liste des « gagnants ».
La « bière des vivants » passe successivement devant le Palais-Égalité (le Palais-Royal) ; l’église Saint-Roch dont le parvis et les gradins accueillants sont remplis habituellement de monde ; le porche du couvent des Jacobins, où, dans la cour, au fronton du club, on lit l’écriteau : « Atelier d’armes républicaines pour foudroyer les tyrans »; puis l’entrée de la place des Piques (place Vendôme), avec, à l’opposé, l’entrée de la cour des Feuillants, siège de la Constituante et, un peu plus loin, sur le même côté, à l’angle de la rue Saint-Florentin, l’église de l’Assomption. On pourra apercevoir, éventuellement, sur le trottoir d’en face, la silhouette d’un Robespierre descendu, pour l’événement, de la maison Duplay qui a une façade sur la rue.
Le Palais-Égalité
L'église Saint-Roch
La bière des vivants passe devant les Jacobins
L'entrée du couvent des Feuillants et, à droite, celle de la place Vendôme ; au fond, le dôme de l'église de l'Assomption.
Enfin, après le virage à gauche où l’on entrevoit au fond à droite le temple des Victoires (l'Église de la Madeleine), le cortège s’engage dans la rue de la Révolution (rue Royale). Cette voie qui mène par le Garde-meuble (aujourd’hui l’Hôtel de la Marine) sur lequel est inscrit comme sur presque tous les bâtiments réquisitionnés : « Liberté, égalité, fraternité ou la mort », est la dernière ligne droite vers la place de la Révolution (Place de la Concorde). C’est le lieu terminal où l’on est invité à « jouer à la main chaude » ; à moins de poursuivre tout droit sur le pont de la Révolution (Pont de la Concorde et ancien Pont Louis XV) comme le fera Bailly pour passer « la tête à la chatière » au Champ de Mars.
La « place rouge »
Durant les années de la Terreur, aux heures ordinaires, la place de la Révolution est un lieu peu fréquentable, couvert de flaques de sang séché et impossible à décrasser à cause de la fréquence des mises à mort. Y viennent se nourrir des meutes de chiens et des nuages de grosses mouches. La place est d’une odeur intolérable en été et les passants qui s’y rassemblent ou qui ne peuvent éviter de la traverser, en emportent des échantillons collés à la semelle de leurs souliers. Vincent Arnault nota dans ses souvenirs que malgré les couches de sable, un jour de fête de prairial, des bœufs, les naseaux remplis soudain de l’odeur, se cabrèrent et ne purent avancer que forcés à grands coups d’aiguillon. La statue du roi Louis XV avait été arrachée de son socle le 12 août 1792 et, quand il mit la tête à la lucarne, son petit-fils ne put voir que le tronçon d’un pied du cheval qui était resté fixé à la pierre. Ce qui faisait dire aux moqueurs que la tyrannie avait encore le pied dans l’étrier. L’échafaud avait été installé, pour le roi, dans l’axe de l’avenue des Champs-Élysées, quelques mètres derrière le piédestal, face aux jardins des Tuileries.
À partir du début août 1793, on érige sur l’ancien socle une statue monumentale de la Liberté, que la majorité des auteurs attribue à Lemot, faite de plâtre et restée en plâtre car comme beaucoup d’ouvrages, faute de finances, elle ne sera jamais coulée. On l’a dit coloriée de rouge par le peintre Girardin, mais rapidement délavée et rosie par les pluies. L’échafaud fut alors déplacé de l’autre côté, face à la statue. On entrevoit cette spectatrice hautaine et impassible dans nombre de gravures de l’époque. Au premier anniversaire de la « mort du dernier tyran », on planta un arbre de la liberté, les témoins nostalgiques se souvenant de ce fameux jour du début de pluviôse où on avait « égorgé le gros cochon » et dansé en chantant la Marseillaise et en criant « Voilà la tête du tyran à bas ! ».
On fêta officiellement pendant plusieurs années de suite cet anniversaire, mais le décret, resté anonyme, n’a pas été reporté dans le Moniteur. Lors des exécutions, l’emplacement favori des curieux était les terrasses dominantes des Tuileries, près de la Renommée de marbre. Le logement du Suisse qui gardait l’entrée du Pont Tournant fut occupé par une auberge, appelée « Cabaret de la Guillotine », très fréquentée des privilégiés pendant les heures de travail de la machine. Ensuite, l’histoire de l’allégorie de la « Liberté » varie selon les auteurs. La matière fragile de l’effigie finit par craqueler sous les intempéries et perdit peu à peu son revêtement de couleur par écaillement et la « Liberté » fut un temps appelée « la galeuse ». Un faisceau de quatre-vingt-trois lances (le nombre de départements français) aurait fini par la remplacer. Pour la cérémonie du 14 juillet 1799, une nouvelle statue est refaite et peinte en couleur bronze ; mais elle demeurera un peu moins de deux ans.
"Sous la Terreur, les premières exécutions firent recette, on payait vingt à trente sous une place assise à la terrasse des Tuileries. L'habitude venant, il n'y eut bientôt plus personne autour de l'échafaud. Il fallut des "vedettes" pour attirer du monde: l'exécution de Desmoulins et de Danton, celle de Robespierre et de ses amis"
La mort de Louis XVI. On chanta la marseillaise, on dansa la carmagnole et on cria « Voilà la tête du tyran à bas ! »
La fournée des Girondins. La statue de la Liberté ; les 2 chevaux de l'entrée des Tuileries: ceux de la Renommée et de Mercure ; en arrière-plan : le Garde-Meubles ; et, en bas, à droite, la charrette où gît le cadavre de Valazé
Place de la Révolution. La statue de la Liberté attribuée à Lemot.
Les théâtres d’exécution de la Terreur
La première exécution au moyen de la guillotine se déroule donc le 25 avril 1792 sur la place de Grève (actuelle place de l'Hôtel-de-Ville), et le supplicié s'appelle Nicolas Jacques Pelletier. Tous les condamnés à mort sont désormais exécutés en ce lieu, jusqu’à ce que l’échafaud soit transporté, le 21 août, sur la place du Carrousel, face au palais des Tuileries, siège du dernier gouvernement, pour l’exécution des premiers prisonniers de la conjuration du 10 août ; d'abord Collenot d’Angremont puis, le surlendemain, Arnaud de Laporte, intendant de la liste civile. La première place est, donc, vouée aux délits de droit commun (châtiment du pilori compris) tandis que la seconde le sera aux crimes politiques. Le 27 août, la guillotine est de nouveau en place de Grève pour trois faussaires d’assignats. Le 21 janvier 1793, la guillotine est exceptionnellement dressée sur la place de la Révolution pour l’exécution de Louis XVI, ancien hôte des Tuileries. Enfin, le 11 mai, la guillotine, sur la proposition des Conventionnels, qui délibéraient désormais aux Tuileries et s’en trouvaient gênés, quitte définitivement la place du Carrousel pour s’installer place de la Révolution, devant l’entrée du jardin (« le pont tournant »), notamment pour y décapiter sur le lieu même de leur forfait certains des voleurs du diamant bleu de la Couronne. Là seront exécutés : Charlotte Corday (17 juillet), la reine Marie-Antoinette (16 octobre), les Girondins (31 octobre), Philippe Égalité (6 novembre) et Danton (5 avril 1794), pour les plus connus. La machine y reviendra spécialement pour exterminer les Robespierristes à partir du 28 juillet 1794. Le 9 juin 1794, elle est transférée place de la Bastille, où, dit-on, elle n’aurait fonctionné qu’une seule journée, car les commerçants et les habitants du quartier Saint-Antoine ayant protesté énergiquement, elle doit s'éloigner bientôt du côté de la barrière de Vincennes (qui prendra le nom de « Barrière-renversée », raccourci de « barrière du Trône renversé ») pour s’élever, le 13 juin, place du Trône-Renversé (anciennement « place du Thrône » et actuellement place de la Nation).
Place de Grève (Hôtel de ville)
Place de la Réunion (place du Carrousel)
Place de la Révolution (place de la Concorde)
Place Antoine (place de la Bastille)
Place du Trône renversé (place de la Nation)
Esplanade du Champ-de-Mars (exécution de Bailly)
Place de Grève : jusqu'au 21 août 1792 ; puis à partir de novembre 1794 jusqu'à mai 1795. Le 7 de ce mois de mai, il y aura 16 exécutions dont celle de Fouquier-Tinville.
Place de la Réunion : du 21 août 1792 au 11 mai 1793.
Place de la Révolution : du 12 mai 1793 au 8 juin 1794
Du 25 août 1792 au 24 mars 1794, les inhumations ont lieu au cimetière de la Ville-L’Évêque dit de la Madeleine : principalement, les victimes du 10 août, les deux souverains, les Brissotins, Manon Roland, les Hébertistes, Madame Du Barry et Charlotte Corday (dans un premier temps, mais son corps fut retiré pour être ensuite déposé aux Errancis). Du 25 mars 1794, au 7 juin 1794, les inhumations ont lieu au cimetière des Mousseaux, dit des Errancis : principalement, la sœur du roi, les Dantonistes, les Robespierristes (exceptionnellement, le cimetière a été rouvert pour eux, le 28 juillet), les Fermiers généraux dont Lavoisier, les « Vierges de Verdun », Adam Lux, les Malesherbes, et Charlotte Corday (dans un deuxième temps).
Du 25 août 1792 au 24 mars 1794, les inhumations ont lieu au cimetière de la Ville-L’Évêque dit de la Madeleine : principalement, les victimes du 10 août, les deux souverains, les Brissotins, Manon Roland, les Hébertistes, Madame Du Barry et Charlotte Corday (dans un premier temps, mais son corps fut retiré pour être ensuite déposé aux Errancis).
Du 25 mars 1794, au 7 juin 1794, les inhumations ont lieu au cimetière des Mousseaux, dit des Errancis : principalement, la sœur du roi, les Dantonistes, les Robespierristes (exceptionnellement, le cimetière a été rouvert pour eux, le 28 juillet), les Fermiers généraux dont Lavoisier, les « Vierges de Verdun », Adam Lux, les Malesherbes, et Charlotte Corday (dans un deuxième temps).
Esplanade du Champ de Mars : le 12 novembre 1793. Pour l'exécution de Bailly (désigné coupable de la fusillade du Champ de Mars)
Place Antoine : du 9 juin 1794 au 12 juin 1794 (la date la plus communément admise).
Place du Trône renversé : du 13 juin 1794 au 27 juillet 1794
Du 9 juin 1794 au 21 juin 1794, les inhumations ont lieu au cimetière Sainte-Marguerite : principalement, les Sainte-Amaranthe et les Renault, le prince de Rohan, et les Sombreuil. Environ trois cents corps. Du 22 juin 1794 au 27 juillet 1794, les inhumations ont lieu au Cimetière de Picpus, creusé dans le jardin du couvent des Augustines de Notre-Dame de Lépante. Au 9 juillet 1794, une première fosse est pleine. On compte environ mille trois cent-quinze corps : principalement, les Carmélites de Compiègne, le poète André Chénier, Roucher, et les deux frères Trudaine.
Du 9 juin 1794 au 21 juin 1794, les inhumations ont lieu au cimetière Sainte-Marguerite : principalement, les Sainte-Amaranthe et les Renault, le prince de Rohan, et les Sombreuil. Environ trois cents corps.
Du 22 juin 1794 au 27 juillet 1794, les inhumations ont lieu au Cimetière de Picpus, creusé dans le jardin du couvent des Augustines de Notre-Dame de Lépante. Au 9 juillet 1794, une première fosse est pleine. On compte environ mille trois cent-quinze corps : principalement, les Carmélites de Compiègne, le poète André Chénier, Roucher, et les deux frères Trudaine.
Les Tuileries à l'époque révolutionnaire
Plan du cimetière de la Madeleine
Plan du cimetière des Errancis
Vues du cimetière de Picpus (début XX siècle)
Les hommes face à la guillotine
Mourir comme un Romain

Les agapes des Girondins, la veille de leur exécution
Comme la plupart de ses condisciples, Desmoulins envisageait déjà, vers 1790, son destin politique conduit par la formule d’Horace « Dulce et decorum est pro patria mori », dont il s’était donné une traduction personnelle : « Je me sens la force de mourir sur un échafaud avec un sentiment de plaisir ». On ignore si plaisir il y eut, mais on ne compte plus, à l’image du courage et de la résignation devant la mort de ceux qui restèrent fidèles à leur foi ou à leur roi, les attitudes impavides des prosélytes de la Révolution, que rassurait sans doute la douceur promise de la guillotine : « une chiquenaude sur le cou » avait résumé Lamourette. Le convoi des plus insolites fut celui des trois charrettes des Girondins (plus une pour Valazé) qui, après les agapes fraternelles de la veille faites en prison, furent une vingtaine à partir ; ils se levèrent à l’approche des Jacobins pour chanter un couplet improvisé sur l’air de l’« hymne des Marseillais » . « La mort ne saurait m’effrayer ; si ma tête est utile au salut de la République, qu’elle tombe ! ». C’est cette abnégation fataliste d’un Chabot qui fit mourir nombre d’entre eux comme des Romains, le stoïcisme antique s’étant mué en une vertu républicaine. Toutefois, certains refusèrent par le suicide d’aller à l’abattoir public. Parmi les plus connus, Roland, qu’on trouve percé de part en part d’une épée, Dufriche-Valazé, Philippe Rühl et Clavière se poignardent au cœur ; Rebecqui se noie ; Lebas, Lidon, Jacques Roux, Maure, Pétion, Buzot et Barbaroux se donnent un coup de pistolet, le dernier se manque et finit ses souffrances sur l’échafaud. Plus tard, ce sera le tour de six anciens Montagnards, surnommés les Crêtois, qui se tailladeront les veines au ciseau dont trois, cependant, survivront pour connaître le choc de la lame.
Inégaux sous le couperet
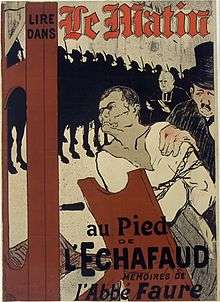
Affiche pour « Souvenirs de la Roquette », par un aumônier des prisons
Ces caractères inaltérables avaient fini aux yeux du peuple par représenter la normalité. Ainsi, un juge déclara à Jacques Cazotte que sa fille avait sauvé une première fois de la sentence fatale : « Va, reprends ton courage, rassemble tes forces, envisage sans faiblesse le trépas ; songe qu’il n’y a pas droit de t’étonner ; ce n’est point un instant qui doit effrayer un homme tel que toi ». Pour le dithyrambique Michelet, les « hommes de la liberté » arboraient une fleur à la bouche sur le chemin de la guillotine. Une probable allusion à Jourdan Coupe-Tête, le « glaciériste » d’Avignon qui, pour donner une dernière touche à son cruel périple révolutionnaire, ne pouvait pas moins faire qu’une dernière crânerie en mâchant, debout sur la charrette, une branche de lilas. Pour Jules Claretie : « On meurt bravement en pleine Terreur », et les rapports de police, nous dit Fleischmann, le confirment. Mais la bravoure ne fut sans doute pas aussi commune quand il était politiquement correct de préserver le caractère d’humanité proclamé du « rasoir national » ; d’autant moins que la description émotionnelle des derniers instants n’était pas le fort des « observateurs de l’esprit public ». Les réactions des suppliciés furent, d’une fournée à l’autre, très contrastées, et les chroniqueurs en ont apporté des témoignages contradictoires.
On a, de fait, trop vite oublié les gens ordinaires, qui représentent plus d’un tiers des victimes parisiennes, et près des deux tiers des victimes en France. Avec un peu d’attention, on aurait pu deviner à leur physionomie fantomatique le reflet d’une grande frayeur. Riouffe fait remarquer que le « courage n’est peut-être pas le mot propre à caractériser la résignation à une mort inévitable. Ceux qui mouraient avec un vrai courage, pense-t-il, avaient de l’éducation, les autres n’en avaient pas, « mais s’il eût fallu s’exposer pour secourir son semblable, à coup sûr le dévouement se serait trouvé du côté des hommes grossiers qui pleuraient ». Cet auteur aurait pu ajouter que certains, souvent parmi les plus humbles, avaient de la religion. Ce qu’en dit l’abbé Carrichon est d’autant plus précieux qu’il demeure un des rares témoins oculaires à avoir rapporté par écrit une scène entière d’exécution, celle de Madame de Noailles, qui fit partie du même convoi que sa mère et sa fille : « Ces signes, d’une grande piété si vive, d’une éloquence si touchante, faisait dire à mes tigres [la foule qui hurle autour de lui, et qui « rit et s’amuse de ce spectacle désolant »] : Ah ! celle-ci, comme elle est contente, comme elle lève ses yeux au ciel, comme elle prie ! Mais à quoi ça lui sert-il ? » Puis, par réflexion : Ah ! Les scélérats de calotins ! »
Une guillotine qui rend fou
On a constaté, sous la Terreur, une angoisse mortifère tout autant qu’une insouciance indéfinissable. Ainsi, l’administrateur des domaines, le royaliste Montjourdain dont la sérénité est surprenante, prend-il le temps de composer et chanter une longue romance à l’attention de la jeune femme qu’il vient d’épouser et qu’il doit quitter bientôt : « L’heure avance où je vais mourir, l’heure sonne, la mort m’appelle… » . Cette chanson, composée sur l’air « C’est aujourd’hui mon heure de barbe », eut un beau succès chez les Ci-devant. Un dénommé Gosnay, beau garçon et d’une franche gaieté avait servi dans l’armée. Pris dans une rixe, il se mit dans la pire situation alors même qu’il aurait pu facilement s’en dédouaner. Nonobstant les conseils de sa famille, par ses réponses fantaisistes, il fut finalement déclaré coupable et, au désespoir de ses proches et de son amoureuse, se laissa mener tout souriant à la guillotine comme s’il allait essayer un jeu nouveau.
Le « jeu de la guillotine »
Les rapports de police et de tribunaux sont surprenants, car, à côté de personnes qui pleurent en silence, à chaudes larmes, sanglotent, hurlent ou gémissent : « quelques-uns dansent sur la charrette, font des farces ou des singeries, saluent avec élégance, à droite, à gauche, le public, sourient à leurs amis rencontrés sur la route […] ». Le plus étrange pourrait être un fatalisme nonchalant, non exempt d’une certaine hauteur, qu’affectionnèrent des Ci-devant. Louis Blanc s’est fait l’écho du jeu de la guillotine et la Comtesse Dash en développe un épisode où des détenus s’exercent quotidiennement à recevoir le coup fatal « avec grâce » : « L’idée fut trouvée sublime ; on simula l’échafaud par la table à manger, un escabeau à deux étages représenta l’escalier, une ou deux chaises tinrent lieu de la fatale machine, les prisonniers se rangèrent à l’entour comme au spectacle, et chacun monta l’un après l’autre pour s’essayer ». Ce simulacre se répétait jusqu’au moment de l’appel du geôlier, ce messager de la mort : « Quand un nom était prononcé, celui qui le portait embrassait ses amis à la hâte, […] et le dernier adieu était souvent une plaisanterie. Pas une plainte, pas une faiblesse, on eût juré qu’ils partaient pour un voyage de plaisir ».
Les femmes devant l’échafaud
L’illustration la plus frappante du mépris de la mort est l’attitude de Charlotte Corday, dont aucune clameur, aucune injure ne put troubler l’impassibilité presque extatique. Une si belle contenance qui avait subjugué Adam Lux, avait agacé l’assistance au point que sa tête fut retirée du sac et souffletée, par exaspération et dépit. On ne peut non plus passer sous silence le maintien hautain de Marie-Antoinette d'Autriche, la veuve Capet, malmenée par un procès douloureux, qui déclarait que « désormais, plus rien ne pouvait lui faire de mal ». Assise sur la charrette, elle montra une « tranquillité féroce », et répondit par un fier isolement aux clameurs d’une foule rendue d’autant plus haineuse. Un dessin fameux, de la plume du peintre David qui l’exécrait, en marqua la moue dédaigneuse.
Celle qui fit taire les huées

Madame Dubarry tirée hors de son cachot
On blâma, a contrario, avec la même vigueur, la contenance vile et lâche de la courtisane « Jeanne Vaubernier Du Barry » (elle signait ainsi, mais sans majuscules) qui hurla sa détresse et qu’on désigna « la seule femme qui n’ait pas su mourir ». Le Peletier avait jugé la décollation un châtiment aristocratique par excellence et trop spectaculaire « que les plus endurcis eussent affronté par bravade ou par philosophie ». Pourtant, Sanson, au moment de relater l’exécution du général Biron, un autre personnage imperturbable – il voulut, raconte l’exécuteur, finir son plat d’huîtres avant de monter sur la charrette - mais qu’on n’avait, contre toute habitude, ni frappé ni injurié, fit cette mention : « Depuis la mort de madame Dubarry, les citoyens sont moins acharnés contre les condamnés. Si tous criaient et se débattaient comme elle l’a fait, la guillotine ne durerait pas longtemps ». Ces souvenirs du célèbre bourreau, certes apocryphes mais pas forcément sans fondement, sont corroborés par le témoignage d’un homme de la connaissance de la duchesse d’Abrantès qui se remémore une scène que celui-ci vécut lors de la dispersion de la foule après l’exécution de l’ancienne maîtresse royale : « [Il] entendait deux femmes du peuple dont l’une disait à l’autre : Comme elle a crié celle-là !... S’ils criaient tous comme ça, je n’y viendrais plus ». Celle qu’on traita de « lamentable épave monarchique », s’était jusqu’au bout montrée devant ce peuple dont elle était si proche et qu’elle avait tout à coup sorti de sa torpeur, ce qu’elle avait toujours été : une femme attachée simplement à la vie et à ses plaisirs. Sur la charrette, ses lamentations, sa frayeur, ses demandes à l’aide répétées embarrassent la foule qui se retire, déconcertée, comme honteuse. Ce n’est plus, en effet, une victime indifférente à son sort, presque pressée d’en terminer avec un supplice qui paraissait rapide et indolore mais « quelqu’un comme eux » qu’on s’apprête à égorger.
Une guillotine misogyne
Madame Loras venue supplier vainement Georges Couthon de faire libérer son mari.
S’ils s’accommodent des femmes qui battent le pavé et servent leurs desseins, les Jacobins sont impitoyables envers celles qui leur résistent. Leur désinvolture à leur égard est souvent doublée d’un cynisme cruel. Vincent Arnault dans ses « Souvenirs d’un Sexagénaire » fustige ces bourreaux qui firent tomber à Paris les têtes de quelque trois-cent-soixante-dix femmes : « comme un polisson fauche des roses avec sa baguette ». Une mère de famille de dix enfants, vient supplier Georges Couthon de rendre la liberté à son mari, homme de bien, mais d’ancien régime... Ce Jacobin, qui ne vient réellement en aide qu’aux sympathisants, la renvoie aussitôt devant la Commission révolutionnaire de Lyon. Là, on lui transmet immanquablement une « lettre d’élargissement » qui la réconforte et qu’elle court porter à la prison : c’était, pour l’infortuné père de famille, un passe-droit prioritaire pour la guillotine. On ne compte plus toutes ces femmes éperdues qui ont sollicité la grâce pour leur époux. Collot d’Herbois est un de ceux qui ne supportent pas celles qui ont cette audace et il les fait punir d’une exposition de six heures sur l’échafaud, les pieds dans le sang encore frais des suppliciés.
Les maîtres de la Terreur ne goûtent guère non plus la plaisanterie, à moins que ce soit la leur. Éléonore de Faudoas est condamnée pour avoir écrit dans une lettre, qui est sortie, on ne sait comment, du cercle privé, une phrase qui a plusieurs versions mais qu’on peut résumer ainsi : « Ma chienne a mis bas trois petits républicains » ; on ajoute parfois : « que j’ai baptisés Liberté, Égalité et Fraternité ». Le 13 juillet 1794, elle est décapitée à l’âge de dix-huit ans et, pour faire le compte équivalent de trois « antirépublicains », on a fait monter avec elle, sur l’échafaud, son père et sa tante. Cette histoire est semblable à celle du perroquet auquel la propriétaire, Françoise de Béthune avait appris à répéter « Vive le roi ! » La jeune épouse d’un certain Lavergne, officier devenu invalide et condamné à mort, ne parvient pas à le sauver malgré ses supplications devant le juge, qui conclura qu’étant encore jeune et belle, elle a une occasion unique d’être débarrassée d’un vieux mari encombrant.
Leur ressentiment n’épargne pas non plus les aïeules. Madame Monaldy, veuve de quatre-vingt-huit ans, impotente et pratiquement aveugle, est mise en accusation au vu d’un courrier qu’elle a reçu et dont le contenu désapprouve une mesure révolutionnaire. Elle est portée devant le tribunal qui la condamne à mort pour avoir « discrédité les assignats », puis elle est hissée jusqu’à la planche de la guillotine. Une autre, atteinte de surdité, obtient la réponse : « Vous avez donc comploté sourdement ». La liste est longue, à tel point que Michelet, lui-même, est contraint de reconnaître qu’on n’a pas hésité à exécuter de « vieilles femmes idiotes ». Cent-trois personnes, âgées de soixante-dix ans et plus, furent éliminées par le seul couteau de Sanson. À ce sujet, Fleischmann rappelle le mot odieux de Joseph Le Bon, à Arras : « Nous avons fait du bon ouvrage aujourd’hui. Nous avons fait guillotiner des vieilles. À quoi servent-elles ? Cela était inutile sur la terre ».
Les « Fiancées de la guillotine »
Fleischmann écrit encore, en paraphrasant Madame de Staël, « qu’envoyer les femmes à l’échafaud pour leur opinion, c’était avouer qu’elles étaient capables et dignes d’en avoir une ». Les femmes n’avaient pourtant pas attendu une révolution pour émettre des idées ou les diriger, car elles ont souvent régné dans les salons du siècle des Lumières. Les Jacobins, qui les accueillirent fraîchement au sein de leur club, ont, de leur côté, implicitement reconnu « en coupant la tête aux femmes comme aux hommes le droit qu’elles avaient de se mêler aux affaires publiques » et, en même temps, « le tort qu’elles avaient d’en user ». Olympe de Gouges de qui on mettra la tête à la « petite fenêtre », n’a pas dit autre chose dans sa « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Pour la première fois, des femmes se retrouvent donc sur le devant de la scène politique ; et c’est la grande nouveauté surgie à l’ombre de la guillotine nationale : séduites par les idées nouvelles mais voulant conserver leur liberté à se déterminer, elles décident à leurs risques et périls d’affronter le pouvoir en place et tentent d’influer sur le cours de l’histoire.
Charlotte Corday arrivant auprès de l'échafaud
Marie-Antoinette saisie par la plume de Louis David
Cécile Renault arrêtée près du domicile de Robespierre
Émilie de Sainte-Amaranthe représentée sur la charrette
Les héroïnes
Une des plus grandes figures de la Révolution fut sans conteste Charlotte Corday. On ne compte plus les portraits, plus ou moins ressemblants, que l’on a faits d’elle ; encore moins les ouvrages qui lui furent consacrés, jusqu’au théâtre qui l’illustra. Cet « ange exterminateur » mourut avec le contentement d’avoir accompli un devoir essentiel. « Seule tu fus un homme, et vengeas les humains », rimera André Chénier. Cécile Renault, jeune fille naïve et désintéressée, âgée de vingt ans, soupçonnée parfois d’être un peu simplette, était partie pour interpeller les faiseurs de désordre parisiens. Elle n’a pas de but déterminé, à l’exception de la curiosité déclarée, à l’endroit de Robespierre, de « voir comment est faite la figure d’un tyran ». Arrivée à Paris, son baluchon sous le bras, avec la seule conviction de préférer un roi à des tyrans, elle avait sereinement envisagé un séjour en prison puis la mort. La guillotine assura donc à ces femmes une publicité sans précédent. Manon Roland dont on a pu dire que « tout ce qui manquait à son mari, [elle] l’avait pour lui », déclarait, dans ses mémoires :« Je ne conçois les femmes s’élevant jusqu’au sublime que par le dévouement, l’abnégation d’elles-mêmes ». Sur l’exécution de cette égérie girondine, victime courageuse de sa liberté d’expression, Fleischmann porte pourtant un jugement sans aménité : « Cette mort brutale assura à la maîtresse de Buzot[…] l’immortalité de l’Histoire. Si elle l’eût évitée, il ne serait demeuré d’elle qu’un médiocre et volumineux fatras de déclamations à la Jean-Jacques ».
Les martyres
Louis Jourdan dans son ouvrage « Les femmes devant l’échafaud » nous fournit une liste (sélective) de ces femmes du peuple qui se sacrifièrent pour des êtres chers, car les condamnations se firent souvent par regroupement familial. Les anecdotes des interventions de la fille de Sombreuil et de celle de Cazotte pour défendre leur père sont exemplaires. L’amour conjugal n’est pas un moindre motif d’élans aussi sublimes que désespérés de la part d’épouses ; notamment celles retrouvées auprès de leur mari dans la charrette au bas de la guillotine et pourtant absentes de la liste des condamnés. Les femmes donnant asile à des réfugiés politiques, voire des Girondins en fuite, cachant des prêtres ou assistant à une messe clandestine, alimentèrent les chroniques, et il revient, sous plusieurs plumes, l’histoire de madame Taupin, de Tréguier, une de celles qui accueillirent ou abritèrent chez elles des prêtres réfractaires. Elle fut dénoncée et condamnée à mort. Elle aurait pu plaider, comme on le lui conseillait, l’ignorance de leur véritable identité et se déclarer favorable aux idées révolutionnaires, mais elle rejeta cette idée pour ne pas donner à ses enfants l’exemple de la lâcheté et du mensonge. Elle leur a montré avec la même ferveur celui du courage en allant à l’échafaud sans révolte et sans un mot, ses enfants ayant été placés à une fenêtre au-dessus de la place. L’épisode des Vierges de Verdun qui refusèrent, elles aussi, de renier leur action, eut un retentissement jusqu’à l’orée du Second Empire, à travers les récits de Lamartine et de Hugo.
Jeune femme traînée à l'échafaud
La complicité avec un prêtre insermenté était punie de mort
Jeune fille consolant son vieux père emprisonné
Aux yeux des révolutionnaires, les religieuses sont « une minorité militante », des femmes sans libre-arbitre, des complices habituelles de réfractaires, et « des dévotes accrochées à leur foi ». Les Carmélites de Compiègne ont, par la force de la littérature et de la musique, acquis une renommée qui a persisté jusqu’à nos jours. Les religieuses d’Arras eurent la malchance d’avoir connu la mainmise de Lebon sur toute la région : elles furent décapitées, en juin 1794, sous l’acte d’accusation de « tuer les malades autant que les maladies elles-mêmes, par les rêves de la superstition et du fanatisme ». D’autres couvents de femmes connurent un sort semblable, victimes d’une persécution qui se prolongea pendant toute la période du Directoire, car il s’agissait d’abord de nationaliser les vastes bâtiments qu’elles occupaient. Ainsi, après les quatre religieuses de Cambrai exécutées en juin 1794, les ursulines de Valenciennes furent expulsées de leur couvent et dispersées à travers la population. Une partie revint se réapproprier leur ancienne maison pendant l’occupation autrichienne. Malheureusement pour elles, la ville fut reprise peu après par l’armée révolutionnaire. En octobre 1794, une dizaine de nonnes résistèrent autour de leur supérieure qu’elles ne voulurent point quitter jusqu’à l’échafaud. Un autre but d’importance était de vaincre les derniers foyers de résistance de la foi chrétienne que les religieuses personnifiaient ; et les vexations contre les communautés perdurèrent jusqu’au Consulat qui devait y mettre fin. Ces femmes font partie des trois cent soixante quatorze martyrs de la Révolution qui ont été récemment béatifiés.
Les enfants des guillotinés
Une des conséquences de la rigueur de la guillotine fut de décimer non seulement de nombreuses familles, en les privant du père puis, parfois, de la mère, mais aussi de les réduire à la ruine et la misère, la confiscation des biens des émigrés et de tout autre ennemi politique étant le socle du système des assignats. Ainsi, les enfants devenus orphelins par la guillotine, trop souvent en bas âge, restaient-ils sans ressources et ne pouvaient-ils compter que sur la charité populaire. Le 4 juillet 1793, la Convention avait statué que les enfants trouvés ou abandonnés seraient adoptés sous la dénomination d’Enfants de la Patrie. Selon leur âge, ils sont élevés dans des hospices, ou éduqués dans des écoles. C’est là que les rejoindront plus tard les nouveau-nés que les femmes enceintes condamnées à mort mettent au monde, et les orphelins victimes de la guillotine.
Un décret du 13 pluviôse (1 février 1795) lève le séquestre des biens pour les condamnés de l’ancien tribunal révolutionnaire. Le député de Versailles, Laurent Lecointre, a rappelé avec véhémence « l’iniquité du séquestre des biens », et réclamé, lors de la séance du 17 ventôse (7 mars) leur restitution avec des paroles qui ont la dureté du style de l’époque :« Acquérir de pareils biens, c’est se nourrir de la chair des cadavres et dévorer la cendre des infortunés ; que dis-je ? c’est manger le sang innocent qui dégoutte de l’échafaud, ou plutôt boire celui de la veuve et de l’orphelin ». Il y eut une vive opposition du parti des Jacobins mais il sera suivi par Bourdon, un député de l’Oise qui avait tenu, à Paris, une école d’orphelins de guerre, Boissy-d’Anglas, et Legendre qui apitoie l’Assemblée : « Si je possédais des biens qui eussent appartenu à une de ces victimes, […] jamais je ne pourrais trouver de repos. »
Premier article de la proposition de Lecointre : Art. I. — Les enfants en bas âge dont les père et mère auront subi un jugement qui comporte la confiscation des biens, sont déclarés appartenir à la République ; en conséquence, il sera assigné un lieu où ils seront nourris et élevés aux dépens du Trésor national.
Le 3 mai 1795, un décret ordonne enfin la restitution de tous les biens séquestrés depuis le 10 mars 1793, à l’exception toutefois de ceux des Bourbons, des émigrés et ascendants (part de « pré-succession »), des concussionnaires et des faussaires.
L'image de l'instrument
« La sainte Guillotine »

Une liste des gagnants « sainte Guillotine »
« On avait fait de la liberté révolutionnaire, une déesse ; on fit de la guillotine une sainte », ironise Georges Duval. On assiste, en effet, sous la Terreur, au transfert d’une religion à une autre. La guillotinade paraissait, par son rite implacable, une cérémonie véritablement sacrificielle. Chalier s’était écrié après avoir brisé un crucifix : « Ce n’est pas assez d’avoir fait périr le tyran des corps, il faut que le tyran des âmes soit détrôné ». Toute une panoplie métaphorique se crée dans la bouche des orateurs révolutionnaires. En route pour assister à une « mise à égalité » d’aristocrates, Voulland annonce d’un air emprunté : « Allons auprès du grand autel voir célébrer la messe rouge ». Les vendeurs de journaux courent les rues en criant : « Voici les noms de ceux qui ont gagné à la loterie de sainte guillotine ». D’ailleurs, ces listes de condamnés sont placardées dans des vitrines de commerçants et des auberges. Ce cynisme outrancier scandalise nombre de citoyens qui, soucieux du respect dû aux décisions du tribunal et aux familles éplorées, réclament l’arrêt de ces publications.
Puis, apparurent les hymnes parodiques, en réponse aux religieuses qui allèrent en chantant au supplice. On remplaça les « Litanies de la Sainte-Vierge » par les « Litanies de Sainte-Guillotine » :
Sainte Guillotine, protectrice des patriotes, priez pour nous ;
Sainte Guillotine, effroi des aristocrates, protégez-nous ;
Machine aimable, machine admirable, ayez pitié de nous ;
Sainte-Guillotine délivrez-nous de nos ennemis…
Ces paroles iconoclastes qui, d’après le dramaturge Georges Duval, prirent leur essor le 21 janvier 1794, pour la commémoration du premier anniversaire de la mort du roi, « furent ensuite chantés dans les rues, dans les carrefours et même dans les Tuileries, sous les fenêtres de la Convention, par les chanteurs publics aux gages des Jacobins et de la Commune ». D’autres chansons étaient composées d’expressions hypocoristiques comme « sainte-guillotinette » qui tendaient à rendre cet instrument amical et familier :
Ils ont fait une oraison
Ma Guingueraingon
À sainte-Guillotinette
Ma Guinguerainguette.
Laure Junot d’Abrantles : « Histoire des salons de Paris » (Ladvocat, 1838) ; tome 3 ; p. 219
Dans ce climat, Marat et Robespierre sont considérés comme de nouveaux prophètes, et l’orateur artésien qui rêve d’instituer une religion de sa conception, est tenu par ses thuriféraires pour un demi-dieu. Il aura droit, lui aussi, à ses litanies et on célébrera, dans la même veine, le « sacré-cœur » de Marat, « deuxième martyr de la Liberté ». Le célèbre tribun d’Arras a conservé avec naïveté, mais non sans vanité, tout un abondant courrier rempli de flagorneries et d’adulations fanatiques, venues de toutes les régions du pays.
La guillotine, objet de mode
La guillotine fut une immense vedette parisienne et induisit des réactions névrotiques. En parures, on se contente, d’abord, de bijoux discrets et sans fioritures, durant les années où la machine « rasait gratis », car la mentalité jacobine est rustique et sobre. Les femmes la portent en broche ou en sautoir, en bagues, épingles ou boucles d’oreilles . Mais passé la chute des Robespierristes, il va apparaître des manières plus ostentatoires, qui allaient devenir une caractéristique des époques du Directoire et du Consulat, et beaucoup contribuer à faire naître chez les Français le goût des modes vestimentaire et capillaire.
Un accessoire du quotidien
Incroyable et Merveilleuse Chez l’homme, le cou est soigneusement protégé du « souffle frais de la guillotine » ; tandis que chez la femme, habillée à la romaine, un ruban rouge « tranche » sur un cou d’albâtre, comme le trait sanglant du couperet
De la représentation, on passe à la fabrication de miniatures. Construites en bois précieux - le bois rouge de l’acajou était naturellement privilégié - ces guillotines furent destinées à orner une cheminée ou un bureau et ne semblent pas être sorties de quelques cercles. Les premiers demandeurs furent les hauts-fonctionnaires et les députés, reconnaissants envers le soutien de leur pouvoir. L’administration des Vivres s’était, d’ailleurs, armée d’un cachet à son effigie avec la légende « Guerre aux fripons », pour dissuader les voleurs de « subsistances militaires ».

Faïence : avec le décor rare d'une exécution par la guillotine

Tabatière « à la guillotine »
On rapporte qu’elle fut l’objet d’un culte extravagant sous le Directoire et la Restauration, mais rien n’assure que ce culte fut aussi répandu qu’il a été décrit sous des plumes thermidoriennes ou royalistes, comme celle de Lamartine, car ont subsisté beaucoup trop de fantasmes et trop peu d’objets témoins. Si certains faits sont indéniables, ils sont isolés. On a révélé l’emploi de guillotines de table qui coupent les fruits au dessert, de celles qui, en place du couteau de cuisine, décapitent les volailles. Le docteur Max Billiard écrit qu’on avait altéré le sens moral au point « qu’on accoutumait les enfants à jouer à l’échafaud ; on vendait de petites guillotines, comme aujourd’hui des « petits soldats ». Charles Nodier précise même qu’au théâtre pour enfants des Champs-Élysées, Polichinelle ne pendait plus les méchants mais les découpait à la guillotine. L’instrument ne tarde pas à monter aussi sur les planches et y remplace la potence. Dès juillet 1793, au « Théâtre des Sans-culottes » (ci-devant Théâtre Molière), fut affichée longtemps une gaudriole : « La Guillotine d’amour ». Il n’y a pas de confirmation qu’elle fut réellement représentée, mais elle produira une chanson paillarde à succès.
Parmi de nombreuses illustrations, la terrible silhouette s’est plus certainement retrouvée sur des fabrications qu’on a dites : « à la guillotine ». Ces produits artisanaux furent assez diversifiés : les tasses, les boutons d’habit, les enseignes de commerce, etc. et surtout les assiettes. Ces faïences patriotiques « ont été longtemps négligées par les amateurs […] qui trouvaient une ample satisfaction dans les chefs-d’œuvres céramiques de Nevers, de Rouen, de Sinceny et de Moustiers ». Le seul ouvrage qui en parle, et aujourd’hui rarissime, est « Céramique révolutionnaire. L’assiette dite à la guillotine », de Gustave Gouellain (1872). Beaucoup de ces articles furent fabriqués tardivement, et selon Alphonse Maze-Sencier , seuls ceux qui le furent depuis la mort du roi jusqu’au 9 Thermidor, devraient recevoir cette appellation. On peut mentionner spécialement la tabatière, objet personnel courant en ce temps-là, comme un support idéal pour la décoration la plus variée ; et si l’on a trouvé des tabatières « à la guillotine », il y en eut aussi « à la Charlotte Corday », « au Bonnet phrygien », « à la Marat », etc.
L’habit « à la victime »
Pour mieux se démarquer des manières frustes de la queue de Robespierre (ses anciens partisans) et autres « buveurs de sang », la jeunesse dorée, issue des couches les plus aisées de la population parisienne, se lance dans un snobisme raffiné et provocant. Au costume grossier des anciens terroristes, en carmagnole et bonnet rouge, on répond par un habit « carré et décolleté », avec des couleurs chatoyantes : chez les garçons, une envahissante cravate « écrouélique », souvent de couleur verte, qui monte jusqu’au menton ; chez les jeunes femmes, une robe « à la romaine », très échancrée qui rappelle, à l’évidence, la chemise du supplicié ; avec, si le temps est frais, un châle rouge jeté sur les épaules en souvenir de la chemise portée par les assassins, et celle de Charlotte Corday, en particulier.
Mais c’est la coiffure qui est la plus ostensible. La chevelure raccourcit, d'abord, très rase, en « porc-épic », qui, chez les femmes, a la faculté de déprécier la beauté ou de renforcer la laideur. Les cheveux peuvent être bouclés ou frisés, et seront portés de différentes longueurs : « à la Titus », selon une mode répandue, dit-on, grâce au comédien adulé Talma qui adopta, pour la scène, la coupe de l’empereur romain. Quand la chevelure est gardée longue, on la relève de l’arrière par -dessus le crâne, rabattue presque sur les yeux, dégageant bien la nuque rasée pour rappeler la coupe des condamnés (dite aussi « à la sacrifiée ») la fixant au sommet de la tête, tenue par un peigne courbe ou nouée par un chignon, et la laissant pendre sur les côtés, soit en oreilles de chien, soit en tresses étroites, appelées cadenettes.
Les bals des Victimés
Dans les cercles où évolue, selon une expression de cette époque, une « société de bon ton », qui, généralement, déplore la perte de nombreux parents, on organise des bals privés, appelés depuis : « bals des Victimés », ou « bals des Victimes ». Les « Victimés », c'est-à-dire ceux qui ont un lien parental étroit avec une ou plusieurs victimes de la répression révolutionnaire ou, simplement, ceux qui en ont de justesse réchappé, comme au lendemain du 9 Thermidor, sont invités à danser au cours d’une fête commémorative où le noir est de rigueur. Les familles endeuillées en profitent pour ménager des rencontres ou des fiançailles entre les jeunes gens orphelins. Mais ces manifestations, certainement plus discrètes qu’on l’a dit, et qui n’ont pas eu, semble-t-il, de témoins directs, donnèrent naissance à des histoires surfaites qu’ont relayées certains auteurs. Exagération ou satire, on a colporté qu’on dansait volontiers parmi les pierres tombales des cimetières, et sur les lieux d’anciens massacres. On parla même de scènes orgiaques. Il n’est pas aisé où porter exactement les soupçons : autant d’anciens jacobins pour stigmatiser des ci-devant désormais triomphants et accusés de mœurs débridées, que de thermidoriens, pour marquer les excès de cette jeunesse dorée, adonnée à toutes sortes d’excentricités.
La mode de 1760 à 1849
Consulat : cheveux bouclés à la Titus ou frisés en « Lantin »
Consulat : Femme coiffée à la Minerve ; à la Vénus ; « à la victime »
Consulat : Homme en « habit carré » ; en houppelande ; coiffé « à la victime »
Au cours de ces soirées spéciales, on y aurait imaginé l’étrange « salut à la victime » qui était de mimer un supplicié au moment de la chute de la lame : on bascule le front en avant et, si l’on recherche l’élégance du geste, on peut exécuter de la tête et des épaules quelques convulsions bien senties, au risque d’être jugé ridicule si elles sont trop maladroites. L’on ne danse que si on a vraiment à déplorer la perte au moins d’un proche parent. Le deuil est, justement, un sujet de conversation qu’il est convenable d’aborder, et on cite sans emphase, tout en dansant, sa parentèle montée à l’échafaud ; parfois, avec un soupçon de cynisme : « Malheureusement, cet oncle n’était pas riche et ne m’a pas laissé une grande fortune ». On se doit de répondre poliment à ce chagrin avec la même sobriété : « C’est quelque chose… Vous êtes bien à plaindre... Comme c’est fâcheux ! ».
Une exécution au temps des Deibler
Photographie gravée d'une guillotine de l'époque de Deibler avec autographe de l'exécuteur
Les guillotinades de la Révolution ont eu un aspect particulier mais gardaient une procédure des plus simples : tout de suite après leur condamnation, un acheminement des individus, en charrette, légèrement habillés, les mains liées derrière le dos, normalement attachés aux ridelles, dans une atmosphère de parade lugubre, avec des soldats et des gendarmes à cheval. Les condamnés arrivés devant les bois de justice, descendent et attendent dans un ordre défini pour monter à leur tour sur l’estrade. Ceux qui restent au pied n’entendront que le bruit de la machine, ponctué par les applaudissements de la foule. Quelques décennies plus tard, le pénal a repris ses droits et l’ambiance n’est plus du tout la même et bien que des détails techniques puissent différer, la procédure sera similaire sous toutes les républiques. Un service d’ordre commandé par le commissaire divisionnaire dégage les abords de la prison et empêchera le moment venu une curiosité trop pressante, voire une excitation de la foule qui, tant qu’elle fut autorisée, est soigneusement tenue à distance. On peut imaginer que l’endroit est la place de la Roquette et que le condamné est un homme.
Le dernier viatique

Un condamné assisté de l'aumonier
La présence de l’aumônier est importante car elle est le dernier dialogue avec le supplicié et celui-ci y trouve souvent un dernier apaisement. Sans doute, pour cette raison, même au cœur de la répression la plus dure, les révolutionnaires qui avaient aboli l’habit ecclésiastique et le culte catholique sous peine de mort, avaient conservé l’habitude des anciennes justices criminelles, d’envoyer auprès des condamnés un prêtre, évidemment constitutionnel, mais ils feront quelques exceptions comme pour le roi. Ainsi, Fouquier, dès qu'après une audience, il avait pris connaissance de la liste des condamnés, la transmettait-il aussitôt à l'évêché. Pendant la Terreur, beaucoup de suppliciés restés fidèles à leur foi, se feront bénir et donner l’absolution au cours de leur dernier voyage par un prêtre « insermenté », dissimulé dans la foule. Le rôle primordial de l’aumônier, déjà reconnu par Sanson, dans ses mémoires, fit partie intégrante du protocole sous tous les régimes durant l’activité de la guillotine.
Après les épisodes révolutionnaires, le prêtre a la possibilité de faire de fréquentes visites au prisonnier dans sa cellule afin de tenter de l’amener à résipiscence et l’encourager à bien mourir ; et, si ce dernier est chrétien, il le confesse et le fait communier. En route vers l’échafaud, si le condamné accepte toujours sa présence, il le soutient physiquement et moralement, et ne se séparera de lui que pour lui donner une ultime accolade. Comme les aides du bourreau demeurent muets et indifférents par principe, le prêtre est le seul contact humain que pourra connaître un condamné à ses dernières minutes. L’aumônier le suivra encore jusqu’au lieu de son inhumation.
Le dernier réveil

Le réveil du condamné dans sa cellule
Les exécutions sont habituellement matinales. À deux heures et demie, les aides du bourreau apportent les bois de justice et termineront sans bruit leur assemblage en moins d’une heure. L’exécuteur vérifie une dernière fois le jeu du couteau dans les rainures et va sans précipitation prévenir le directeur de la prison qui emmène quatre de ses gardiens pour assister le condamné. Sont généralement présents le préfet de police, le commissaire du quartier, le juge d’instruction, le chef de la sûreté (ou son représentant), le greffier de la Cour d’Assises (obligatoire pour les constatations légales), les avocats du condamné, un médecin (généralement celui de la prison) et un ministre du culte (généralement, l’aumônier des prisonniers).
À trois heures quarante, le directeur, le juge, le commissaire, le greffier et l’aumônier pénètrent discrètement dans la cellule du condamné qui n'est pas au courant la veille au soir qu'il va être exécuté. Le directeur touche le dormeur à l’épaule ou, s’il dort profondément, le secoue légèrement. Le condamné qui s’éveille et ouvre péniblement les yeux, est souvent surpris mais comprend rapidement à la vue de la délégation qu’il est près de la fin. Le directeur le nomme et ajoute « Votre recours en grâce a été rejeté » ; « Levez-vous » ; « Préparez-vous à mourir ». L’attitude du condamné est variable selon les caractères. De l’hébétude totale à la tristesse la plus résignée, il reste généralement silencieux. L’homme se lève lentement de son lit et s’habille machinalement, boutonne sa chemise, enfile son pantalon et ses chaussures. Sa veste est jetée sur ses épaules si la matinée est trop fraîche. Le directeur lui adresse les mots rituels : « Avez-vous quelques vœux à formuler ? » ; « Si vous avez des révélations à faire, monsieur le Juge d’instruction est là pour les recevoir ». Puis il demande : « Si vous voulez rester quelques instants avec monsieur l’Aumônier, nous allons sortir ». Ce tête-à-tête ne durera pas plus de 5 minutes, juste avant le passage en salle de greffe pour la « dernière toilette » pendant laquelle, on lui raccourcit les cheveux derrière et on lui dégage le cou et les épaules en échancrant le col de sa chemise qu’on referme plus bas par une épingle. Il peut être revêtu de la camisole. On lui accorde la possibilité d'écrire une dernière lettre à sa famille, de boire un cordial (rhum ou vin) et de fumer une ou deux cigarettes.
L’arrêté du préfet de police de Paris, J. M. Pietri, en date du 6 juillet 1870, fit renoncer à faire « revêtir indistinctement les condamnés à la peine de mort de la camisole de force à partir du jour de leur condamnation ». Cette précaution fut remplacée par une surveillance spéciale (article 1). Il est prévu aussi pour abréger les préparatifs de veiller à ce que tous ces condamnés « aient toujours les cheveux courts » et soient, au moment de leur notification de l’exécution, « revêtus d’une chemise sans col » (article 2). Enfin, il impose que « le trajet de la cellule à l’échafaud soit aussi direct et aussi court que possible » (article 3). Une légende veut que l'aumônier à la tête de la procession brandisse un crucifix devant le condamné à mort pour l'empêcher de voir la guillotine jusqu'au dernier moment.
Lorsque l’exécuteur qui est venu avec deux aides ou plus, « trace sa signature sur le registre d’écrou, le condamné lui appartient. Il le fait asseoir sur l’escabeau, toujours le même, et l’un des aides lui entoure les jambes avec des ficelles nouées au-dessus des chevilles. Un autre aide procède à la ligature des mains [à l’arrière]. Deux cordes serrent les épaules et viennent s’attacher à celle qui réunit les poignets. Les cordes serrées obligent le patient à porter la poitrine droite et à effacer les épaules. La dernière ligature ramène les jambes aux poignets et paralyse tout mouvement du corps en avant ».
Les trois coups du dernier acte

Sortie d'un condamné conduit au supplice
Les portes de la prison s’ouvrent rapidement. Le condamné apparaît les pieds entravés et les mains liées derrière le dos, ce qui l’oblige d’avancer à petits pas. Le plus souvent, à cette heure précoce, il ne pourra guère apercevoir qu’une lueur blafarde qui lui renvoie la grande ombre menaçante de l’appareil de mort et son grand panier. Le supplicié regarde la guillotine et souvent il pâlit un instant. Les observateurs réguliers ont aussi noté qu’un condamné même parmi les plus stoïques ne regarde jamais deux fois l’instrument. Cette remarque rappelle Sanson qui plaçait toujours sur la charrette les victimes dos au cheval ou dos à l’échafaud quand elles attendaient leur tour. L’homme baisse les yeux, s’avance lentement en silence ou en poussant de longs soupirs, ou bien s’il est en état de choc, à demi-inconscient, il est aidé par l’aumônier qui lui passe le bras sous le sien ou, si besoin est, par un ou deux gardiens de la prison. Au pied de la machine, l’aumônier prie, l’exhorte à se comporter courageusement et l’embrasse ; puis le supplicié est laissé aux mains des aides de l’exécuteur. Le plus souvent, il a un réflexe de recul quand on l’approche de la planche contre laquelle il sera sanglé. Cette planche se dresse depuis le haut de ses chevilles jusqu’à mi-poitrine. Une fois ligoté, les bourreaux flegmatiques le font basculer à l’horizontale et la planche glisse et s’arrête quand le cou est entre les poteaux. Les aides lui tirent les épaules vers l’avant et l’allongent avec force pour bien le déplier horizontalement. Parfois, les aides prennent un temps plus ou moins long pour maîtriser un condamné excité et le disposer correctement sur la planche.
Le cou est posé sur la traverse demi-circulaire où vient s’abattre le châssis demi-lune qui maintient la tête prisonnière. Ce « casse-tête » eut tendance, avant que sa fixation soit modifiée, à tomber à contretemps et frapper rudement le crâne du patient. De plus, ce châssis, pendant une période, avait été armé d’un grappin qui immobilisait la nuque en pénétrant dans les chairs. Cet accessoire qui amenait une souffrance inutile et occasionnait des cassures de la région occipitale, fut supprimé du temps de l’exécuteur Nicolas Roch, prédécesseur de Louis Deibler. La tête est donc désormais manipulée par un des bourreaux afin qu’elle se présente bien au couteau. Le tranchant lourdement lesté de plomb, d’un poids de trente à soixante kilogrammes, inversement proportionnel à la hauteur des « bras » qui peuvent atteindre 4 mètres ; et de trente-cinq centimètres de large pour une lame plus étroite de trente, est relevé par une corde qui passe par une poulie fixée au « chapeau » (le montant horizontal supérieur). Pour le modèle, ce peut être un crochet en forme de 8 qui, à partir du centre de ce linteau, maintient en l'air le mouton. La partie inférieure de ce crochet s’ouvre quand on pince la partie supérieure. Il s’agit pour l’exécuteur de s’avancer et de toucher un déclic, un petit levier qui pousse un ressort et libère la lame, les branches du haut se rapprochant et celles du bas s’écartant. La chute du couperet est amortie par deux puissants ressorts à boudin caoutchoutés placés en dessous, de sorte que ses rebords ne viennent pas claquer violemment en fin de course mais produisent un bruit sourd. Pour descendre deux mètres quatre-vingt le mouton met trois-quarts de seconde.

La guillotine prête à recevoir le condamné
Depuis la Révolution, la chute du bloc tranchant dans les rainures est la hantise des exécuteurs. Anatole Deibler le fera équiper, ainsi que la planche à sangles, de galets pour mieux assurer son glissement. Les incidents furent assez rares mais mémorables. L’exécution d’un nommé Pierre Hébrard à Albi est resté fameuse dans les annales de la fille à Guillotin. D’abord, ce condamné à mort attendit cinq mois en prison l’annonce de son dernier jour (un record). Par comble de malchance, le 12 septembre 1831, cinq fois le couperet sera tombé sur son col sans vraiment l’entamer car le couteau n’est plus dans son aplomb et déraille. Un aide se dévoue pour le découper à la dague, sous les injures et une pluie de cailloux. À la fin, le chef exécuteur est poursuivi jusqu’à son domicile dont on casse les vitres. Si la victime du condamné n'avait pas été très aimée de la population, le bourreau aurait été mis à mal. Ce dernier fut pourtant innocenté par l’expertise de la machine qu’on avait imprudemment laissée pendant deux jours accessible au public. On a conclu, en effet, au sabotage d'un jeune aide licencié depuis peu. Un autre incident concerna la décapitation de l'assassin Languille le 29 juin 1905 pour laquelle le médecin de service le Docteur Beaurieux put constater que le condamné demeurait conscient trente secondes après la chute du couperet (confirmation de cette observation par expériences sur des rats en 2011).
Après le bruit de la planche qui se rabat, le bruit de la demi-lune qui se referme, enfin le bruit du mouton qui finit sa course en rasant la face extérieure de la lunette, un flot de sang jaillit. La tête rejetée en avant fait un bang sonore en tombant au fond de la bassine en zinc, récipient avec un bord ressemblant à un « dossier de baignoire » pour avoir été relevé à la suite d’incidents où des têtes sautèrent et roulèrent plusieurs mètres jusqu’aux pieds des spectateurs. Le reste du corps est poussé rapidement sur une planchette rabattue en plan incliné qui le fait tomber dans le grand panier ; la tête retirée par les cheveux ou les oreilles va le rejoindre entre les jambes. « Le glaive tombe avec une rapidité foudroyante, oblique ; il agit à la fois comme coin, comme masse et comme faux avec une puissance irrésistible ». Il peut être quatre heures et, normalement, il ne s’est pas passé plus de vingt à trente minutes depuis le réveil du supplicié. Mais c’est une éternité pour un spectateur impressionné pour qui tous les gestes des acteurs du drame paraissent effectués « au ralenti ».
Si le corps n’a pas été réclamé par la famille, il est parfois apporté au laboratoire médico-légal pour autopsie. Le supplicié est souvent mis en bière, mais un cadavre abandonné perd parfois toute considération aux yeux des fonctionnaires de la mort : « Chaque fois, à l'arrivée du fourgon, on en descend le panier qui renferme le corps, la tête et la sciure de bois imprégnée de sang. À peine monsieur l'abbé Croze est-il éloigné que le contenu du panier est brutalement renversé dans la fosse : le corps roule au fond et quelle que soit la position dans laquelle il tombe, on le laisse et on le recouvre de terre. Ce matin, le cadavre de Billois a été étendu sur le ventre et la tête a été placée entre les cuisses, de manière que le visage était caché. Ce procédé [...] choque la décence [...] ».
L’hémorragie du décapité

Une des rares images d'époque où l'on voit l'effusion de sang d'un décapité
Le sujet n’est jamais vraiment abordé dans les divers récits car il occupe rarement les esprits à cet instant dramatique et incite au poncif. Il faut donc se tourner vers des conclusions de médecins physiologistes. L'exécution de Carrara du 25 juin 1898 se raconte ainsi : « Une énorme giclée de sang inonde la chaussée, avant que son corps tombe dans le panier ». Or, la décapitation de cet assassin fut justement observée et analysée par le docteur Capitan. Dans son propos, il ajoute les remarques de deux confrères.
Exemple de l’assassin Carrara
Carrara, depuis le départ de sa cellule, s’est montré complètement comateux, anéanti par l’annonce de sa mort imminente et demeure « exsangue et livide ». On l’a pratiquement porté jusqu’à l’échafaud et il a semblé « absolument inerte et cadavérique » sur la planche où il n’a eu aucune réaction. La section du cou tranché de Carrara saignait fort peu dans la lunette. Au moment où il fut projeté dans le panier, le tronc ne tomba pas entièrement au fond car les épaules heurtèrent le rebord et le cou resta en dehors. C’est à ce moment-là seulement qu’un sang rouge jaillit des carotides dans un jet estimé approximativement d’un mètre en hauteur et d’un mètre cinquante en avant.
Il est évident que le sang circule grâce aux battements autonomes du cœur. Le docteur Gley qui a étudié régulièrement en laboratoire de nombreux cœurs de suppliciés, eut l’occasion en province d’examiner deux cadavres de guillotinés, deux minutes seulement après la « détroncation » : un seul avait le cœur qui battait (il fonctionna encore huit minutes) tandis que, chez l’autre, il fut trouvé à l’arrêt. Dans ce dernier cas, comme pour Carrara, le cœur ne battait plus, ou presque plus, au moment de la décollation. Il ne peut s’agir pour les médecins que d’un état syncopal qui est la conséquence d’un stress important. Le plus fréquemment, l’excitation médullaire lors du passage violent de la lame va faire repartir le système cardiaque et le sang sera projeté quelques secondes plus tard.
Exemple de Manon Roland
Étude de deux têtes de suppliciés. Géricault
Les conclusions des médecins viendront confirmer ce que de rares témoins avaient rapporté au cours de la période de la Terreur. Un observateur exceptionnel fondu dans la foule venue au supplice de Manon Roland, un discret monarchiste nommé Bertin, fut rempli d’admiration devant l’intrépidité de madame Roland qu’il n’avait aucune raison d’apprécier et qui mourut dans toute la force de son âge (39 ans). Il raconte :« Quand le couteau eut tranché la tête, deux jets de sang énormes s’élancèrent du tronc mutilé, ce qu’on ne voyait guère : le plus souvent la tête tombait décolorée, et le sang que l’émotion de ce moment terrible avait fait refluer vers le cœur, jaillissait faiblement ou goutte à goutte ».
Le docteur Laborde résume ces deux conditions essentielles. D’une part, le patient conserve toute son énergie et une lucidité stoïque qui lui permet d’affronter sans affres une fin qu’il comprend inéluctable ; et son sang jaillit presque spontanément. La puissance du jet témoigne de contractions cardiaques au moins normales, sinon avivées par le choc de la séparation. Les décapitations d’Anastay et de Vaillant, individus « pleins de vie », provoquèrent « une hémorragie artérielle immédiate ». Cette autonomie cardiaque est de longueur variable : généralement de vingt minutes à une heure trois-quarts. Dans cette condition, le cœur termine toujours à vide, en systole, en une « véritable contracture énergique » qui l’immobilise définitivement.
Le deuxième cas, le patient est tout à fait à l’exemple préalablement cité de Carrara. Il est « sidéré, comme anéanti à la nouvelle de l’heure fatale, incapable de se tenir debout, soutenu ou plutôt porté jusqu’à la guillotine, demi-mort d’avance, en état de syncope […] ». « Demi-mort » : on retrouve une semblable expression chez Restif de la Bretonne. Le cœur est affaibli ou pratiquement à l’arrêt, et le jaillissement sanguin est très réduit ou retardé. Le coup du tranchant une fois porté, l’organe récupère de la syncope et reprend brusquement ses battements, puis continue selon ce que la gravité de son état syncopal lui a laissé de force. La persistance des contractions cardiaques post-mortem est évidemment limitée et le cœur finit par s’arrêter « en état de flaccidité, plus ou moins dilaté par des caillots asphyxiques ».
Les lieux d’exécution en France, après la Révolution
Les lieux d’exécution parisiens
Après les gouvernements révolutionnaires, les exécutions se déroulent à nouveau sur la place de Grève. C’est là que sont guillotinés Georges Cadoudal (en 1804) et les quatre sergents de La Rochelle (en 1822). À partir du 4 février 1832, la guillotine est installée devant la barrière Saint-Jacques (actuelle place Saint-Jacques). C’est là que sont exécutés Pierre-François Lacenaire (1836) et plusieurs auteurs d’attentats contre Louis-Philippe, parmi lesquels Giuseppe Fieschi. Le 29 novembre 1851, l’échafaud est transféré devant la prison de la Grande Roquette (à l’emplacement actuel des n° 166-168, rue de la Roquette). Y sont exécutés Orsini (1858), auteur d’un attentat contre Napoléon III, le médecin Désiré Couty de la Pommerais ayant empoisonné ses patientes pour récupérer leurs assurances-vies (**) et les assassins en série Jean-Charles-Alphonse Avinain (1867) et Troppmann (1870).
En novembre 1870, l’échafaud disparaît et la guillotine est désormais montée à même le sol (sur cinq dalles toujours visibles aujourd’hui rue de la Croix-Faubin, au débouché de la rue de la Roquette). Ceci après que l’un des derniers directeurs de la prison de la Roquette a cru bon de faire desceller ces pierres aux fins de les revendre, et qu'il restitua, cependant elles furent scellées à un autre emplacement que celui d'origine, et appareillées différemment elle ne forment plus la croix originelle. À partir du 5 août 1909, la guillotine est utilisée à l’angle du boulevard Arago et de la rue de la Santé, devant la prison du même nom. C’est là que sont exécutés les membres de la Bande à Bonnot et Paul Gorgulov. C’est à Versailles que se déroule la dernière exécution publique, celle d’Eugen Weidmann, le 17 juin 1939, devant la prison Saint-Pierre. Pendant l’Occupation, les hommes sont guillotinés dans la cour de la prison de la Santé, les femmes, dans celle de la prison de la Petite-Roquette (à l’emplacement du n° 143, rue de la Roquette). Et c’est finalement à Marseille, aux Baumettes, qu’a lieu la dernière exécution capitale, celle d’Hamida Djandoubi, le 10 septembre 1977.
Les lieux comme champ d'expérience pour les médecins

L'exécution d'Henri Languille le 28 juin 1905 à Orléans.
Les médecins à l'origine de ce châtiment, Joseph Ignace Guillotin et Antoine Louis s'inscrivent dans le contexte des préoccupations humanistes des Lumières, illustrées par la pensée de Cesare Beccaria exprimée dans Des délits et des peines. Néanmoins, dès les premières années de pratique de la guillotine, le milieu médical s'affronte en deux écoles à propos de la survivance après le couperet : thèse de la mort immédiate et impeccable ou celle de la mort différée et barbare, cette dernière thèse étant renforcée par le fait que les 83 guillotines montées dans les départements sont souvent des copies imparfaites obligeant le bourreau à s'y reprendre plusieurs fois. Aussi dès 1798, la guillotine devient un champ d'expérience médical : on interpelle la tête du guillotiné pour y observer des réactions (le médecin-chef Gabriel Beaurieux constate en 1905 que le condamné nommé Henri Languille, fraîchement décapité réagissait en ouvrant les yeux à l'appel de son nom), on la pique ou la soufflette (telle Charlotte Corday), on teste la survie d'organes isolés, notamment le cœur : stimulations au scalpel, expériences électriques avec la « bouteille électrique » de Galvani puis la « pile » d'Alessandro Volta, à partir des années 1880 expériences de « ressuscitation » ou de « revivification » (transfusion du sang de chien sur des têtes décapitées par le docteur Laborde notamment).
À la suite du scandale d'Henri Pranzini, guillotiné en 1887 et dont la peau après sa dissection publique est utilisée pour faire des portefeuilles et des porte-cartes, les condamnés peuvent demander à obtenir la libre disposition de leur corps post-mortem, ce qu'obtient Stanislas Prado en 1888, tandis que d'autres condamnés à mort font don de leur corps à la science.
L’occultation progressive de la publicité des exécutions en France
Le code pénal de 1791 dispose que l'exécution doit se faire en public, ce qui attire un public appartenant à toutes les couches sociales : public de fonction, « carré des privilégiés » près de la guillotine (grâce à des laissez-passers obtenus auprès de la préfecture ou de la mairie), bourgeois louant des chaises, fenêtres, échelles et même lorgnettes de théâtre, foule maintenue loin de la guillotine par un cordon de policier ou même masquée par une barrière en bois, par le fourgon placé dans son axe de vision ou par l'échafaud placé de plain-pied (décret-loi de 1870). Sous la Troisième République, des dizaines de villes disposent de guillotines : il s'y produit des centaines d’exécutions publiques qui peuvent attirer plusieurs dizaines de milliers de curieux. À l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, l’Agence Cook loue plusieurs cars pour conduire les touristes à la double exécution d'Allorto et Sellier. 566 personnes (dont quatre femmes) sont exécutées entre 1870 et 1939, année de l'exécution d'Eugen Weidmann en plein jour, ce qui permet à des journalistes de prendre la plus importante série de photographies d'une exécution capitale (elle est également filmée). De plus, la foule y déborde le service d'ordre. Devant ces troubles à l'ordre public, le président du Conseil Édouard Daladier fait saisir les numéros de presse avec leurs photographies et promulgue le 24 juin 1939 un décret-loi abolissant les exécutions capitales publiques (abolition en 1868 en Angleterre, en 1860 aux Pays-Bas, projet de loi rejeté par la Chambre des députés en France le 4 décembre 1898). Après cette exécution, les condamnés à mort sont guillotinés dans l'enceinte des prisons à l'abri des regards de la foule. La mesure est effective dès l'exécution suivante, celle de Jean Dehaene, le 19 juillet à Saint-Brieuc.
En fait, cette mise au secret s'opère progressivement dès le XVIII siècle sous l'impulsion des élites dont les sensibilités sont heurtées par cette « mort sale » (magistrats ou politiques qui considèrent que cette exécution ne remplit plus son rôle historique d'exemplarité et lui préfèrent la peine de l'emprisonnement, certains journalistes s'identifiant à l'exécuté, médias friands de sensationnalisme qui veulent être les seuls à couvrir la publicité de l'exécution) et des autorités qui constatent que cette technologie politique jugée inefficace donne lieu à des troubles publics (par exemple public invectivant la police lors de l'exécution d'anarchistes dans les années 1890). L'abandon public de cette « technologie de pouvoir » (expression de Michel Foucault) a lieu en plusieurs phases : le rituel exécutionnaire sur la place centrale de la ville laisse la place à une exécution sur une place en périphérie puis devant la prison et enfin dans la cour d’enceinte des prisons ; parallèlement sa durée et le cérémonial sont progressivement réduits, de même que le nombre d'exécutions (augmentation des exécutions doubles triples ou quadruples à cet effet) ; le rituel se produit de plus en plus la nuit (pas au petit matin ou dans la journée pour éviter son côté spectaculaire -au sens littéral du terme, pas trop tôt le soir pour éviter que les noctambules et demi-mondains aillent finir leurs soirées au « spectacle », munis de leur « journal des raccourcis ») : l'exécution est reportée à l'aube à partir de 1832. La suppression de cette publicité est une solution de compromis entre les abolitionnistes (en attendant l'abolition de la peine de mort, ils sont satisfaits que ce spectacle sanglant soit sorti de l'espace public) et les rétentionnistes, partisans de la peine capitale (ils considèrent que l'abandon de cette publicité est une bonne solution pour rendre la peine de mort plus acceptable).
Les domiciles de la guillotine
En 1793, l’accusateur public du Tribunal révolutionnaire Fouquier-Tinville, ordonne au bourreau Charles-Henri Sanson de trouver un lieu où entreposer la « veuve ». Elle élira finalement domicile chez l’ingénieur du département de la Seine, nommé Demontier.
Lorsque Jean-François Heidenreich devient bourreau en 1849, la machine est déménagée au 11-13, rue Pont-aux-Choux, dans le quartier du Marais. Puis il la fait déplacer de nouveau, cette fois-ci dans un hangar situé au 60 bis, rue de la Folie-Regnault, à deux pas des prisons de la Roquette. Elle y restera ainsi cinquante ans.
En 1911, alors que la Roquette est démolie, Anatole Deibler décide de déménager la guillotine dans une remise tout fraîchement construite de la prison de la Santé, à l’angle de laquelle se déroulent toutes les exécutions parisiennes.
Puis en 1978, le dernier exécuteur, Marcel Chevalier, reçoit de l’administration l’ordre de déplacer les « bois de justice » à la prison de Fresnes, où doivent avoir lieu désormais toutes les exécutions. Cependant la guillotine restera définitivement muette, les quatre derniers condamnés à mort ayant tous été graciés.
Depuis l’abolition de la peine capitale en 1981, les guillotines sont conservées en plusieurs lieux : les bois de justice parisiens ont été déposés à Marseille, au Musée national des arts et traditions populaires (désormais « Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée » - MUCEM) ; deux guillotines issues de départements d’Outre-Mer sont conservées au « Musée national des prisons » dans les sous-sols de l’ancienne prison de Fontainebleau.
En Belgique, une guillotine est visible au musée de la Vie wallonne de Liège, une autre au musée Gruuthuse de Bruges, une troisième, incomplète, à la citadelle de Dinant.
En Algérie, la guillotine de la prison de Serkadji, vestige de l'époque coloniale française, est exposée au Musée central de l'Armée à Alger.
Exécutés renommés
25 avril 1792 : place du Carrousel à Paris, le voleur de grand chemin Nicolas Jacques Pelletier, terrassier de son état, fut le premier condamné à mort guillotiné.
21 janvier 1793 : place de la Révolution (aujourd’hui place de la Concorde) à Paris, Louis XVI, roi de France.
17 juillet 1793 : place de la Révolution à Paris, Charlotte Corday, pour l’assassinat de Jean-Paul Marat.
16 octobre 1793 : place de la Révolution à Paris, Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France.
3 novembre 1793 : place de la Révolution à Paris, Olympe de Gouges, femme de lettres et pionnière du féminisme.
6 novembre 1793 : place de la Révolution à Paris, le duc Philippe d'Orléans, dit Philippe Égalité.
8 novembre 1793 : place de la Révolution à Paris, Manon Roland, communément appelée Madame Roland, figure de la Révolution française.
17 novembre 1793 : place de la Révolution à Paris, Jean Nicolas Houchard, général sous la Révolution française.
8 décembre 1793 : place de la Révolution à Paris, Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV, roi de France.
5 avril 1794 : place de la Révolution à Paris, Georges Jacques Danton, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine.
8 mai 1794 : place de la Révolution à Paris, Antoine Lavoisier, le « père » de la chimie moderne.
27 mai 1794 (8 prairial an II) : Mathieu Jouve Jourdan, révolutionnaire français impliqué dans les massacres de la Glacière.
17 juillet 1794 (29 messidor an II) : place du Trône-Renversé à Paris (actuelle place de la Nation), les seize carmélites de Compiègne.
25 juillet 1794 (7 thermidor an II): place du Trône-Renversé à Paris, le poète André Chénier.
28 juillet 1794 (10 thermidor an II) : place de la Révolution à Paris, Maximilien de Robespierre et son frère Augustin, Louis Saint-Just et vingt de leurs compagnons.
7 mai 1795 (18 floréal an III) : place de Grève à Paris, Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire.
27 mai 1797 (8 prairial an V) : place de Grève à Paris, Gracchus Babeuf.
21 septembre 1822 : exécution dite des Quatre sergents de La Rochelle.
2 octobre 1833: dans la cour de l’Auberge de Peyrebeille, dite l’« Auberge Rouge », les époux Martin et leur valet Rochette.
9 janvier 1836 : barrière St-Jacques à Paris, Pierre-François Lacenaire.
19 février 1836: Giuseppe Fieschi, pour l'attentat du boulevard du Temple, le 28 juillet 1835, contre le roi Louis-Philippe I, qui fit dix-huit morts. Il fut exécuté avec ses complices, Pépin et Morey.
28 novembre 1867: exécution du boucher Jean-Charles-Alphonse Avinain. Auteur du mot fameux devant le couperet : « Messieurs, n’avouez jamais ». Il avait espéré jusqu’au bout la « perpétuité » en récompense de ses aveux de deux assassinats.
19 janvier 1870 : terre-plein de la Roquette à Paris, Jean-Baptiste Troppmann, assassin d’une famille de huit personnes.
11 juillet 1892 : Montbrison (Loire), François Koënigstein, dit Ravachol, le « Christ de l’anarchie ».
5 février 1894 : Auguste Vaillant, activiste anarchiste français.
27 avril 1913 : Callemin, Ellie Monnier et Soudy, survivants de la bande à Bonnot pour avoir fait le braquage de la société générale à Chantilly.
3 août 1921 : Jacques Mécislas Charrier, fils de Mécislas Golberg est le dernier anarchiste français à monter sur la guillotine.
25 février 1922 : à Versailles, Henri Désiré Landru, assassin de dix femmes et d’un jeune garçon.
2 juillet 1932 : à Cologne Peter Kürten, dit le vampire de Düsseldorf, pour le meurtre de neuf personnes.
17 juin 1939 : à Versailles, Eugen Weidmann, assassin de six personnes (dernière exécution publique en France)
18 octobre 1940 : Hans Vollenweider, dernier condamné à mort de Suisse, guillotiné à Sarnen.
22 février 1943 : décapitation de « La Rose blanche » (Die Weiße Rose en allemand). Trois étudiants allemands d’une vingtaine d’années sont guillotinés dans la prison de Stadelheim, à Munich (Allemagne). Leur crime est d’avoir dénoncé le nazisme dans le cadre d’un mouvement clandestin. Parmi eux Hans et Sophie Scholl.
30 juillet 1943 : Marie-Louise Giraud, avorteuse (l’avortement était sous le régime de Vichy, un « crime contre la famille française »).
25 mai 1946 : Marcel Petiot, assassin d’au moins vingt-sept personnes.
19 juin 1956 : Ahmed Zabana, premier condamné à mort de la guerre d’Algérie.
11 février 1957 : Fernand Iveton, seul Européen guillotiné de la guerre d’Algérie (pour « tentative de destruction d'édifice à l'aide d'explosifs » n'ayant causé ni dégâts, ni victimes).
1 octobre 1957 : Jacques Fesch.
28 novembre 1972 : exécution de Claude Buffet et Roger Bontems (pour prise d’otages, et Claude Buffet seulement, assassinat). C'est l'avocat de la défense, Robert Badinter, qui, devenu ministre de la Justice, réussira en 1981 à faire abolir la peine de mort en France.
28 juillet 1976 : Christian Ranucci, pour le meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla, en juin 1974 (de nombreuses demandes de révision posthume ont été rejetées).
23 juin 1977 : Jérôme Carrein pour l’assassinat d’une fillette de huit ans.
10 septembre 1977 : dernière exécution, celle de Hamida Djandoubi, pour la torture et l’assassinat d’une jeune femme.
Imaginaire populaire
La guillotine fut baptisée initialement « Louisette » ou « Louison » (inspiré du chirurgien royal Antoine Louis qui a préconisé la mise au point d’une machine à lame oblique), avant de prendre son nom définitif (au grand désespoir du docteur Guillotin).
Pendant la Révolution française, elle fut surnommée le « grand rasoir national », le « moulin à silence », la « cravate à Capet », la « Mirabelle » (par rapprochement à Mirabeau), « l’abbaye de Monte-à-Regret », le « vasistas », la « veuve » (par les escrocs) ou la « raccourcisseuse patriotique ».
En Angleterre, elle symbolisa dès 1793 les excès de la Révolution française; on la retrouve dans L'Histoire de la Révolution française de Thomas Carlyle ou dans Un conte de deux villes de Charles Dickens. Mais pendant la Terreur, elle fascinait, provoquant l'effroi et la révulsion, mais servant également à des usages humoristiques ou satiriques.
Au XIX siècle, on la surnommait la « lucarne » et au XX siècle le « massicot » ou la « bécane » (ces deux derniers termes étant employés par les bourreaux), ou encore les « bois de Justice ».
Le terme de « bascule à Charlot » a été également utilisé en référence au premier exécuteur à l’avoir employée : Charles Sanson, celui de « veuve à Deibler » fait référence à la lignée de bourreaux qui succéda aux Sanson, les Deibler père et fils.
Lorsque les exécutions avaient lieu place de la Roquette, on a appelé la guillotine « l’abbaye de Saint-Pierre », jeu de mots sur les cinq pierres en croix qui marquaient son emplacement (et que l’on peut toujours voir).
Louis-Ferdinand Céline surnommait la guillotine « le prix Goncourt des assassins ».
Les assistants de l’exécuteur des hautes œuvres étaient surnommés « accordeurs de piano » (possible référence à Tobias Schmitt, créateur de la première guillotine et qui était un facteur de clavecins ?).
Voici quelques expressions populaires, relatives à la guillotine et à son usage :
Accomplir une action qui va immanquablement entraîner la peine capitale (c’est-à-dire risquer la peine de mort). Y aller… (du cigare, de la tronche, du gadin, du citron, du chou…) et, généralement autres substantifs signifiant la tête. Aller… (comme précédemment, accompagné des mêmes substantifs), sans le « y », signifie : subir le châtiment suprême.
Y aller… (du cigare, de la tronche, du gadin, du citron, du chou…) et, généralement autres substantifs signifiant la tête.
Aller… (comme précédemment, accompagné des mêmes substantifs), sans le « y », signifie : subir le châtiment suprême.
Aller à son châtiment se dit : Aller… (à la butte, à l’abbaye du Monte-à-Regret, au rasoir, au coiffeur, à la veuve, marier (ou épouser) la veuve, passer à la découpe…).
Aller… (à la butte, à l’abbaye du Monte-à-Regret, au rasoir, au coiffeur, à la veuve, marier (ou épouser) la veuve, passer à la découpe…).
Subir le châtiment se dit : Éternuer dans la sciure, dans le son, dans le sac, dans le bac, dans la bassine… Se faire raccourcir… d’une tête, de 30 centimètres… Se faire décolleter la gargane, couper le sifflet, ou le kiki (s’emploie aussi pour « se faire égorger »). Mettre (ou passer) la tête (ou autre mot d’argot signifiant tête) dans la lunette, au guichet… Mettre le nez à la fenêtre. Se faire photographier. Cette expression vient du fait que l’aide exécuteur (celui qui tire la tête du condamné au travers de la lunette) est surnommé le « photographe ».
Éternuer dans la sciure, dans le son, dans le sac, dans le bac, dans la bassine…
Se faire raccourcir… d’une tête, de 30 centimètres…
Se faire décolleter la gargane, couper le sifflet, ou le kiki (s’emploie aussi pour « se faire égorger »).
Mettre (ou passer) la tête (ou autre mot d’argot signifiant tête) dans la lunette, au guichet…
Mettre le nez à la fenêtre.
Se faire photographier. Cette expression vient du fait que l’aide exécuteur (celui qui tire la tête du condamné au travers de la lunette) est surnommé le « photographe ».
Usage hors de France
Exécution de Arezki El Bachir en Algérie en 1895
En Algérie
Avant le 16 février 1843, il était d’usage de faire décapiter les condamnés à mort au yatagan par des indigènes. À la suite d'une exécution à Alger qui, le 3 mai 1842, avait tourné à la boucherie, le ministre de la guerre, le général Amédée Despans-Cubières, fit introduire l’usage de la guillotine et exigea que les exécuteurs soient français (même après cette décision l’usage du yatagan aurait perduré pendant encore plusieurs années). Dès lors, l’Algérie possèdera sa propre équipe d’exécuteurs, distincte de celles de la métropole (même si Anatole Deibler et son grand-père y exercèrent pendant tout ou en partie de leur carrière).
La guillotine sera en usage en Algérie jusqu’en 1959, année où les exécutions capitales cessèrent. Le pays, devenu indépendant en 1962, abandonnera la « veuve », symbole de la colonisation aux yeux du pouvoir algérien, au profit du peloton d'exécution.
En Allemagne

Guillotine (« Fallbeil ») Bavaroise de 1854
Modèle historique en échelle 1:6
Les modèles utilisés étaient les mêmes qu’en France jusqu’au milieu du XIX siècle. À partir de cette date, les machines à décapitation ont changé d’apparence : d’une hauteur moindre, plus de métal. Le « Fallbeil », comme on l’appelait en Allemagne, demeure en usage jusqu’à l’abolition de la peine de mort dans la République fédérale d'Allemagne (1949) et jusqu’à 1968 en République démocratique allemande.
Hitler utilisa beaucoup la guillotine. On estime que sous le troisième Reich, 16 000 personnes furent guillotinées.
En Belgique
Malgré la période du Royaume des Pays-Bas, la Belgique à son indépendance conserve une partie des lois et des usages hérités de l'occupation française sous la Révolution et le Premier Empire, dont l'utilisation de la guillotine. De 1830 à 1863, cinquante-quatre condamnés sont guillotinés.
Par la suite, la peine de mort n'est plus appliquée jusqu’à ce qu’en 1918, la grâce soit refusée à un condamné. Cinquante-cinq ans après la dernière exécution, il n'existe plus en Belgique ni bourreau, ni guillotine en état de fonctionner. En pleine guerre, on fait donc venir l'un et l'autre de France. La guillotine de Douai, et le bourreau, Anatole Deibler, de Paris, sont escortés par l'armée française. L'exécution a lieu le 26 mars 1918 à Furnes. C’est le dernier usage en date de la guillotine et la dernière exécution d'un condamné de droit commun en Belgique. Il s'agissait du sergent artilleur Émile Ferfaille, reconnu coupable d'avoir assassiné sa petite amie, Rachel Ryckewaert, enceinte de 4 mois. Les seules exécutions après cette date ont lieu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et concernent des collaborateurs et des criminels de guerre, lesquels seront fusillés.
Le Musée de la vie wallonne, à Liège, et le musée Gruuthuse, à Bruges, exposent chacun une guillotine.
En Suède
Les exécutions ont lieu par décapitation à la hache jusqu'au début du XX siècle. En 1903, la Suède acquiert auprès de la France une guillotine qui est utilisée une seule fois lors de l'exécution d'Alfred Ander le 23 novembre 1910. Cette exécution relance en effet le débat sur la peine capitale et toutes les personnes condamnées à mort dans les années qui suivent verront leur peine commuée en réclusion à perpétuité. La peine de mort est abolie en 1921, et Alfred Ander reste à ce jour le dernier condamné à mort exécuté de l'histoire du pays. La guillotine qui a servi à son exécution est conservée depuis 1975 au Musée Nordique à Stockholm.
En Suisse
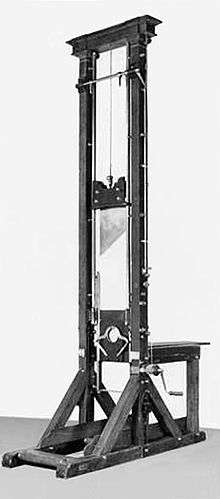
La guillotine du Canton de Lucerne fut utilisée pour toutes les exécutions civiles entre 1879 et 1940.
La décapitation par l'épée fut utilisée en Suisse depuis l'aube de l'ère moderne. Dès 1835, la guillotine est utilisée par quelques cantons. Vu que le droit pénal était l'affaire des cantons jusqu'en 1942, il existait des différences cantonales dans l'utilisation de cette machine. Les derniers condamnés à mort exécutés par l'épée étaient Niklaus Emmenegger (1867 à Lucerne) et Héli Freymond (1868 à Moudon).
En 1874, la peine de mort fut abolie en Suisse au cours de la révision de la constitution fédérale, mais elle sera réintroduite par une initiative populaire en 1879 déjà. Suivant la réintroduction, encore neuf hommes seront décapités, et la guillotine du Canton de Lucerne sera utilisée pour toutes ces exécutions. Huit de ces neuf exécutions eurent lieu en Suisse primitive, et une dans le Canton de Fribourg (Étienne Chatton en 1902).
En 1938, l'assemblée fédérale accepte un code pénal fédéral qui sera valide pour tout le pays, dans lequel la peine de mort est abolie. Cette loi est sujette au référendum facultatif, dans lequel elle sera acceptée avec 53,5% du vote populaire le 3 juillet 1938. Elle n'entre néanmoins pas en vigueur jusqu'au 1 janvier 1942, et deux hommes seront encore condamnés à la mort et guillotinés entretemps : Paul Irniger en 1939 dans le Canton de Zoug, et Hans Vollenweider en 1940 dans le Canton d'Obwald.
Le droit pénal militaire prévoit encore la peine de mort en temps de guerre, et trente hommes seront condamnés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont dix-sept seront fusillés jusqu'à la fin de la guerre. La peine de mort militaire en temps de guerre fut abolie en Suisse en 1992.
Aujourd'hui
En 1996, le démocrate Doug Teper député de l’État américain de Géorgie a proposé de remplacer la chaise électrique par la guillotine pour éviter de faire souffrir le condamné et permettre le recyclage éventuel de son corps. Cette proposition a finalement été rejetée, la guillotine (jamais utilisée aux États-Unis) étant considérée comme une méthode barbare car sanglante. L’État abandonnera la chaise électrique, déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême de Géorgie, au profit de l’injection létale en 2001.
Des ventes aux enchères de guillotines ont lieu occasionnellement, comme celle acquise par un milliardaire texan qui réalise des « guillotine party » (simulacre de l'exécution) ou la guillotine dite « des Armées de la République » adjugée à 223 056 € à l'hôtel Drouot en 2011.
La loi 81-908 portant abolition de la peine de mort ne prévoit pas la suppression du décret du 20 mars 1792 qui établit la guillotine. Or, selon l'édition Dalloz du code pénal de 1981, c'est bien sur ce décret qu'était fondée l'utilisation de la guillotine, l'article 12 de l'ancien code pénal ne faisant que disposer que « tout condamné à mort aura la tête tranchée » sans préciser comment. Ce décret est donc toujours en vigueur aujourd'hui, bien que sans objet.

 词典释义:
词典释义:
 头台;
头台; 头刑
头刑
 头台
头台 头刑
头刑 头台上
头台上 亲人。(阿
亲人。(阿 贡)
贡) 头台
头台 )
)

 考试,
考试, 送人生前途
送人生前途 考试
考试
 考试。(《世界报》)
考试。(《世界报》)


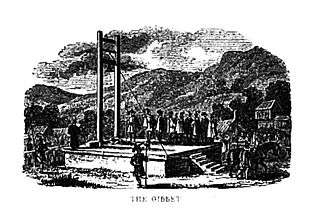

![Dessin authentique[pas clair] d'une guillotine primitive en situation](https://wiki-gateway.eudic.net/wikipedia_fr/I/m/Dessin_de_la_guillotine_primitive.jpg)